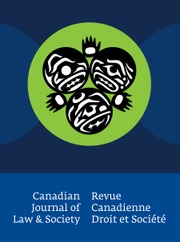No CrossRef data available.
Article contents
La Perception du risque technologique: Le droit entre Janus et Prométhée*
Published online by Cambridge University Press: 18 July 2014
Abstract
With neo-liberal theories, state regulatory function has been challenged, and notably in the field of technologies. Therefore, a number of questions are raised pertaining to the capacity of persons who have suffered injuries or harm from technoscientific activities to obtain reparation through judicial process. Following an exposé of the main theoretical elements of the debate about the relationship between normativity, democratic values and economy, the authors analyse the perception by judges of science and technoscientific risk through the scrutiny of some Québec and Canadian decisions in respect of the relationship between scientific evidence and legal standard of proof. Hence, they discuss the problem of the weight and importance of scientific evidence within the judicial process and also refer to the terms of the debate already engaged in the United States.
Résumé
Avec, sous l'effet des théories néo-libérales, la remise en cause du processus étatique de réglementation, notamment dans les secteurs technonologiques, de nombreuses questions se posent quant à la capacité des personnes ayant subi un préjudice du fait d'activités technoscientifiques à en obtenir réparation par voie judiciaire. Après avoir exposé les principaux éléments théoriques du débat sur les rapports entre normativité, valeurs démocratiques et économie, l'article s'intéresse à la perception de la science et du risque technoscientifique par les juges, à travers l'analyse de certaines jurisprudences québécoise et canadiennes sous l'angle des rapports entre la preuve scientifique et la preuve en droit. Les auteurs discutent ainsi le problème du poids et de de l'importance de la preuve scientifique dans le processus judiciaire et se réfèrent également aux termes du débat tel qu'il se déroule aux États-Unis.
- Type
- Research Article
- Information
- Canadian Journal of Law and Society / La Revue Canadienne Droit et Société , Volume 13 , Issue 1 , Spring/printemps 1998 , pp. 125 - 167
- Copyright
- Copyright © Canadian Law and Society Association 1998
References
1. Ellul, Jacques, Le Bluff technologique, Paris, Hachette, 1988 à la p. 183.Google Scholar Soulignons, dès ores, que dans le cadre de ce travail, nous utiliserons indifféremment les termes «risque» et «danger», même si dans certains secteurs d'activité, comme dans le domaine médical par exemple, la distinction sémantique recoupe des réalités bien déterminées et clairement circonscrites dans l'agir et la formulation normative.
2. Ibid.
3. Ibid.
4. Il s'agit de l'incendie dans une usine de la compagnie de produits chimiques et pharmaceutiques et qui avait entraîné l'écoulement, dans le Rhin, d'insecticides, de produits composés de mercure et autres produits toxiques. Voir Schwabach, Aaron, «The Sandoz Spill: The Failure of International Law to Protect the Rhine from Pollution» (1989) 16 Ecology Law Quarterly 443.Google Scholar
5. Incendie de B.P.C, dans la banlieue de Montréal, Québec.
6. Douglas, Mary et Wildavsky, Aaron, Risk and Culture: An Essay on the Selection of Technical and Environmental Dangers, Berkeley, University of California Press, 1982 à la p. 186Google Scholar [ci-après Risk and Culture].
7. Kates, R. et National Academy of Engineering, dir., Hazards: Technology and Fairness, Washington, National Academy Press, 1986Google Scholar; National Research Council, Risk Assessment in the Federal Government: Managing the Process, Washington, National Academy Press, 1983Google Scholar; National Research Council, Issues in Risk Assessment, Washington, National Academy Press, 1993.Google Scholar
8. Bourgeault, Guy, L'Éhique et le droit face aux nouvelles technologies bio-médicales, Bruxelles, De Boeck-Wesmael, 1990 à la p. 67.Google Scholar
9. Ibid. à la p. 68.
10. Shrader-Fréchette, Kristin, Risk and Rationality: Philosophical Foundations for Populist Reform, Berkeley, University of California Press, 1994Google Scholar [ci-après Risk and Rationality]. L'auteur cite en effet d'autres auteurs, dont Weinberg, A., «Risk Assessment, Regulation and the Limits in Phenotypic Variation in Populations» dans Woodhead, et al. , dir., Phenotypic Variation in Populations: Relevance tu Risk Assessment, Symposium on Phenotypic Variation in Populations: Relevance to Risk Assessment New York, Plenum, 1988, aux pp. 126–27Google Scholar; Risk and Culture, supra note 6 aux pp. 5–7.
11. «Societal risks (such as those from commercial power plants) tend to be imposed involuntarily by industry or government, whereas individual risks (such as those from mammograms) usually are voluntarily chosen by people affected by them.» Risk and Rationality, ibid. à la p. 168.
12. Par exemple, bien que les centrales nucléaires soient orientées vers un niveau de risque zéro en augmentant le contrôle de la pollution, cette réduction du risque peut directement peser en termes de risques économiques plus élevés par l'accroissement du coût de l'électricité.
13. A.L.A.R.A. est l'abreviation anglaise de As Low As Reasonably Achievable, qui signifie que les niveaux de radioexposition et de rejet d'effluents radioactifs seront maintenus à des niveaux «aussi bas qu'il est raisonnablement possible d'atteindre», autrement dit dans le jargon nucléaire courant, seront maintenus A.L.A.R.A.
14. Par exemple, les enfants de Tchernobyl exposés à la radiation.
15. «They err in assuming that radiation risks are ethically acceptable (or may be involontarily imposed) if they are of the same level as volontarily chosen risks. They err because the ethics of risk acceptability is a matter not only of magnitude but also of risk distribution, risk compensation, whether the risk is associated with important benefits, and so on.» Risk and Rationality, supra note 10 à la p. 171.
16. Par exemple, la limite du régime de responsabilité nucléaire pour les États-Unis se situe à 5% du coût total de l'accident de Tchernobyl. Au Canada, on parle d'une échelle dérisoire. Ibid. à la p. 172.
17. Moore, G. E., Principia Ethica, Cambridge, University Press, 1951 aux pp. viii–ix, 23–40, 60–63, 108 et 146.Google Scholar Ainsi, un risque ne doit pas être acceptable si l'on peut éventuellement le réduire. Ce n'est pas, comme l'explique Frechette, parce qu'il y a un certain nombre d'accidents d'automobile considéré comme normal que l'on ne doit rien faire pour corriger la situation. Ibid.
18. Cependant, on doit prendre garde à une fausse participation du public où ce dernier est invité à faire des représentations sans que ses recommandations ou ses observations ne soient généralement prises en considération dans les conclusions relatives à l'évaluation d'une nouvelle technologie ou encore lors de la formulation de normes juridiques.
19. «Even typical definitions of “risk” often reflects the erroneous assumption that experts alone ought to evaluate radiation risk […]» Risk and Rationality, supra note 10 à la p. 172.
20. Canada, Au, la Loi sur l'évaluation environnementale, 1992, c–37Google Scholar, L.R.C. 1985, c. C-15.2 répond à ce besoin. On peut également se référer au N.E.P.A. américain (42 U.S.C.A. s. 10165) qui requiert une déclaration d'impact environnemental pour toutes les activités des agences gouvernementales. Au Canada, cette déclaration n'est imposée que pour les grands projets.
21. Pendant que des études sont poursuivies, le stockage des déchets radioactifs est effectué de manière temporaire, augmentant parfois le risque de dommages importants.
22. Efron, Edith, «Behind the Cancer Terror» (1984) 16:1Reason 24.Google Scholar
23. Jonas, Hans, Le Principe responsabilité: Une Éthique pour la civilisation technologique, Paris, Cerf, 1990 aux pp. 55–56.Google Scholar
24. Ibid. à la p. 56.
25. Wildavsky, Aaron, Searching for Safety, New Brunswick, Transaction, 1988Google Scholar [ciaprès Searching for Safety]; Risk and Culture, supra note 6.
26. Il va même plus loin en appliquant cette analyse essai-erreur dans le secteur nucléaire. En effet, selon lui, dans la gestion de la sûreté nucléaire, s'agissant d'incidents mineurs, une certaine analyse essai-erreur pourrait contribuer à développer une société davantage à l'abri des risques puisqu'elle permet de contrôler les dangers en s'y préparant davantage grâce aux leçons apprises de l'analyse essai-erreur. Dans Risk and Culture, ibid., coécrit avec Mary Douglas, Aaron Wildavsky essaie de légitimer sa théorie en lui donnant une application socio-anthropologique.
27. Searching for Safety, supra note 25 à la p. 2.
28. Ibid. à la p. 77.
29. Ibid. à la p. 2.
30. Hypothèse élaborée par Pearce, David W., «The Preconditions for Achieving Consensus in the Context of Technological Risk» dans Dierkes, Meinolf, Edwards, Sam et Coopock, Rob, dir., Technological Risk: Its Perception and Handling in the EEC, Cambridge, Mass., Oelgeschalger, Gunn & Hain, 1980, à la p. 58.Google Scholar Il est cependant intéressant de noter que l'Environmental Protection Agency des États-Unis applique l'analyse essai sans erreur.
31. Pour Wildavsky, le fait que nous ne puissions pas avoir une connaissance numérique des dangers actuels et futurs justifie une nécessaire préférence pour l'approche essai avec erreur plutôt qu'essai sans erreur. À partir de la comparaison avec les catastrophes naturelles, il conclut que l'ampleur du dommage sera fonction du faible ou haut niveau de technologie, un faible niveau de technologie étant supposé causer plus de dommages.
32. Pour Wildavsky, cette argumentation est inexistante: quels avantages peuvent-ils faire contrepoids aux inconvénients d'un accident dans un réacteur nucléaire? Bien que l'on ait dressé la liste de tous les petits risques possibles reliés à l'utilisation de l'énergie nucléaire, cela ne saurait pallier le danger considérable qu'un accident peut représenter si de fortes doses s'échappent dans l'atmosphère. Aussi, selon lui, la recherche de sûreté devrait être répartie sur différentes sources d'énergie utilisables plutôt que sur une seule source.
33. Searching for Safety, supra note 25 à la p. 77.
34. Aux yeux de Wildavsky, une approche comportant l'ajout de mécanismes n'est pas dangereuse en soi. Cependant, elle peut s'avérer telle lorsqu'on connaît uniquement la réaction de la composante individuelle et non celle du système dans son ensemble.
35. Viscusi, W. K., Risk By Choice, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1983 aux pp. 114–15, 136.CrossRefGoogle Scholar
36. Younger, A. et al. , Report of the Early Siter Suitability Evaluation of The Potential Repository Site at Yucca Mountain, Nevada, Washington; U.S. Department of Energy, 1992.CrossRefGoogle Scholar
37. Bazelon, D., «Risk and Responsibility» (1979) 205 Science 205.CrossRefGoogle ScholarPubMed
38. Nous avons déjà évoqué ailleurs ce processus de réduction du rôle des juristes dans l'entérinement des choix effectués par les scientifiques. Voir Boustany, Katia, «La Normativité nucléaire: Quelques réflexions» (1992) 7:1R.C.D.S. 121.Google Scholar
39. Il est très important de noter que les termes «sceptique» et «respectueux» ne renvoient pas à la science in abstracto mais à la science quant à son utilité dans un système juridique.
40. Il convient de préciser que les catégories élaborées dans le tableau ci-dessous ne constituent que des approximations de la perspective des juges quant à la preuve scientifique. Or, ces catégories sont instables et ambiguës. Par ailleurs, on peut trouver des juges qui se soumettent au consensus scientifique quant aux conclusions, qui vérifient des conclusions en employant le consensus scientifique quant aux méthodes et aux procédures et qui relativisent les conclusions scientifiques. Les catégories les plus simples sont celles du juge qui accepte le consensus scientifique quant aux conclusions et celui qui relativise la centralité des conclusions scientifiques. Ces deux types de juges essaient de laisser l'entreprise scientifique aux scientifiques. Le premier affirme la nécessité d'une preuve scientifique concluante. Le deuxième rejette la nécessité d'une preuve scientifique concluante. Mais pour leur part, les juges qui tendent à être plus actifs par rapport à la preuve scientifique éprouvent davantage de difficultés car ils doivent, qu'ils le veuillent ou non, adopter une définition opérationelle de la science. Le juge qui vérifie la validité de la preuve scientifique, ou qui essaie d'adapter cette dernière à son cadre judiciaire, doit décider de ce qui rend crédible une preuve scientifique qui lui est soumise.
41. Aux États-Unis, les jurés sont souvent les juges des faits dans des causes de responsabilité civile. De ce fait, ces deux étapes sont beaucoup plus distinctes qu'au Canada. Le juge peut filtrer la preuve scientifique mais il arrive très souvent que des jurés décident que la preuve est suffisante pour établir le lien de causalité requis.
42. Voir par exemple Huber, P. W., Galileo's Revenge: Junk Science in the Courtroom, New York, Basic, 1991 aux pp. 218–19Google Scholar où il écrit: «[A]nyone who believes in the possibility of neutral law, as many fortunately still do, must at the same time believe in the existence of objective fact, which ultimately means positive science.» Il ajoute à la p. 225 que «[g]ood judges will cherish the rule of fact even above the rule of law» [sic!].
43. Voir par exemple le jugement du juge Weinstein dans In re «Agent Orange» Product Liability Litigation, 611 F. Supp. 1223 (E.D. N.Y. 1985), aff d 818 F.2d 187 (2d Cir. 1987), cert. denied, 487 U.S. 1234 (1988) cité dans Poulter, Susan R., «Science and Toxic Torts: Is There a Rational Solution to the Problem of Causation?» (1992) 7 High Technology Law Journal 189 à la p. 204, n. 68, à la p. 227Google Scholar, n. 183 et à la p. 232, n. 207 [ci-après «Science and Toxic Torts»]; Black, Bert, «A Unified Theory of Scientific Evidence» (1988) 56 Fordham Law Review 595 aux pp. 674–76Google Scholar [ci-après «Unified Theory»].
44. Voir par exemple Snelle. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311 [ci-après Snell] et texte.
45. Ceci est suggéré, du moins en partie, par Black, Bert, «The Supreme Court's View of Science: Has Daubert Exorcised the Certainty Demon?» (1994) 15 Cardozo Law Review 2129Google Scholar [ci-après «Certainty Demon»] à la p. 2130 où il écrit: «[T]he real question the courts must address is not whether science requires too much certainty, but rather how scientists can validly reach conclusions at the level of certainty the law requires.»
46. Bourcier, Danièle, Ordre juridique et ordre technologique, Paris, C.N.R.S., 1986 à la p. 6.Google Scholar
47. Sans épouser de manière absolue et exclusive de tout autre approche les vues kelséniennes, selon lesquelles le critère du caractère juridique d'une norme réside dans la sanction dont elle est assortie, il n'est pas inutile de rappeler ce que Kelsen écrivait à propos de la finalité du droit: «Envisagé quant à son but, le droit apparaît comme une méthode spécifique permettant d'amener les hommes à se conduire d'une manière déterminée.» Kelsen, Hans, Théorie pure du Droit, 2e éd., Neuchâtel, La Baconière, 1988 à la p. 72.Google Scholar
48. M.-A. Hermitte, «L'Autonomie du droit par rapport à l'ordre technologique» dans Bourcier, supra note 46, à la p. 96.
49. Charbonneau, S., «Norme juridique et norme technique» dans Archives de philosophie du droit, t. 28, Paris, Sirey, à la p. 286.Google Scholar
50. Snell, supra note 43.
51. Lawson c. Laferrière, [1991] 1 R.C.S. 541 [ci-après Lawson].
52. Il s'agit d'un ophtalmologue qui a commencé une intervention chirurgicale pour enlever une cataracte malgré un saignement rétrooculaire. Après l'opération (neuf mois plus tard), l'ophtalmologue a pu constater l'atrophie du nerf optique entraînant la perte de vision de la patiente. Une cause possible de l'atrophie est la pression due à l'hémorragie rétrooculaire. Aucun des témoins experts n'a été en mesure d'exprimer avec certitude une opinion sur la cause de l'atrophie ou sur le moment où elle s'est produite. Lorsque l'affaire fut soumise à la Cour suprême, la faute de l'ophtalmalogue était établie: le juge de première instance avait admis un témoignage selon lequel lorsqu'il y a un saignement autre que celui résultant de la piqûre de l'aiguille, l'intervention chirurgicale devrait être interrompue.
53. McGhee c. National Coal Board, [1973] 1 W.L.R. 1 [ci-après McGhee].
54. Il convient de noter que la décision de McGhee, ibid., était une décision de la House of Lords. De même faut-il souligner que la Cour d'appel s'est fondée sur l'interprétation de McGhee du juge Mustill dans Wilsher c. Essex Area Health Authority, [1987] 2 W.L.R. 425 (C.A.). Voir Snell, supra note 43 à la p. 318.
55. Ibid. à la p. 326.
56. Ibid. à la p. 327.
57. Ibid. Le juge Sopinka avait expliqué aux pp. 326–27: «Si j'étais convaincu que des défendeurs qui ont un lien important avec le préjudice subi échappaient à toute responsabilité parce que les demandeurs sont dans l'impossibilité de démontrer l'existence du lien de causalité en vertu des principes qui sont actuellement appliqués, je n'hésiterais pas à adopter une de ces solutions.»
58. Ibid. à la p. 328 [c'est nous qui soulignons]. Le juge Sopinka a donné gain de cause, en l'espèce, au demandeur.
59. Lawson, supra note 51 aux pp. 546–48. En 1971, une patiente ayant une masse anormale au sein consulta le Dr Lawson qui recommenda une ablation chirurgicale pour établir un diagnostic plus précis. Le rapport pathologique post-opératoire a établi un cancer du sein mais, selon les conclusions du juge de première instance, le médecin n'a pas révélé ce cancer à Mme Dupuis et ne l'a pas conseillée sur les traitements à suivre. De plus, il n'a pas organisé pour elle un suivi à long terme. Trois ans plus tard, un des médecins de Mme Dupuis a découvert le diagnostic de cancer posé en 1971. Par la suite, une intervention générale a révélé la présence d'un cancer généralisé. Apres avoir subi divers traitements et engagé des procédures contre le Dr Lawson, Mme Dupuis est décédée en 1978. Le juge de premiere instance a trouvé que le Dr Lawson avait manqué à son devoir d'informer Mme Dupuis et avait aussi manqué à son devoir d'assurer un suivi. Mais il a néanmoins conclu qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre les fautes du médecin et le dommage invoqué devant lui (la mort de Mme Dupuis) parce que toute la preuve d'expertise ne pouvait le convaincre qu' «il était probable que les chances de survie de madame Dupuis auraient été plus grandes, si elle avait subi un traitement autre que celui pratiqué par le défendeur».
60. Lawson, ibid. à la p. 550. Voir Laferrière c. Lawson, [1989] R.J.Q. 27 (C.A.) (une décision prise à deux voix contre une, le juge Vallerand étant dissident).
61. Ibid. à la p. 559.
62. Ibid.
63. Ibid. à la p. 574. En se risquant «à faire quelques observations» pour expliquer la divergence entre les approches françaises, belges et québécoises, le juge Gonthier a expliqué qu'au Québec, «la probabilité est déjà prise en compte» dans la règle de la prépondérance des probabilités qui est influencée par la théorie de la causalité adéquate, tandis qu'en «France et en Belgique, la certitude de la causalité est généralement exigée» puisque «dans le passé, les régimes français et belge de responsabilité civile se sont fondés plus que le nôtre sur les principes de l'équivalence ou de la théorie de la causalité fondée sur la condition sine qua non». Ibid. aux pp. 601–02.
64. Ibid. à la p. 606.
65. Ibid. à la p. 609.
66. Ibid.
67. Voir par exemple Snell, supra note 43 à la p. 331, où le juge Sopinka cite un arrêt de la Cour suprême des États-Unis visant à établir «une distinction entre les fonctions respectives du juge des faits et celles du témoin expert».
68. Ibid. à la p. 328, où le juge Sopinka cite Lord Salmon.
69. Ibid. à la p. 330. Voir aussi Gonthier, Charles D., «Le Témoignage d'experts: À la frontière de la science et du droit» (1993) 53 Revue du Barreau 187 aux pp. 194–95.Google Scholar
70. Berthiaume c. Val Royal Lasalle Liée, [1992] R.J.Q. 76 (C.S.) [ci-après Berthiaumé] conf. par. Berthiaume c. Réno Dépôt Inc., [1995] R.J.Q. 2796 (C.A.).
71. Ibid. à la p. 164. Notons que dans Berthiaume on retrouve des normes de l'Office des normes générales du Canada qui constituent «un répertoire des règles de l'art dans le domaine pertinent» mais «[s]ans lier les intéressés comme un texte de loi». Ibid. à la p. 108. Cet article n'aborde pas toute la question de «soft law».
72. Ibid., en particulier aux pp. 155 et 163.
73. Il convient, à cet égard, de consulter un ouvrage faisant état d'une enquête édifiante sur les modes de fonctionnement de la recherche scientifique et de la diffusion de ses résultats, et qui met en évidence, notamment, les liens entre les intérêts financiers des industries et les chercheurs scientifiques ainsi que leurs effets pervers, en particulier dans le domaine de la validation de travaux par des publications dans les revues scientifiques. Alfonsi, Philippe, Au nom de la science, Paris, Barrault-Taxi, 1989.Google Scholar
74. Berthiaume, supra note 70 à la p. 97.
75. Ibid. à la p. 98.
76. Ibid. à la p. 119.
77. Ibid.
78. Ibid. à la p. 120.
79. Ibid. à la p. 128. Le juge écrit que «c'est ainsi qu'il [le docteur Nantel] a interprété le mandat qu'il avait accepté, soit d'établir une relation de compatibilité et non une relation causale entre les symptômes des demandeurs et la m.i.u.f.». Voir infra notes 81 à 85 et texte correspondant.
80. Ibid. à la p. 127.
81. Ibid. à la p. 152.
82. Ibid.
83. Ibid.
84. Ibid.
85. Ibid. à la p. 134.
86. Energy Probe c. Canada (P.G.) (1994), 17 O.R. (3e) 717; (1994) 14 C.E.L.R. (N.S.) 245 (Ont. Ct. (Gen. Div.)), le juge Blenus Wright [ci-après Energy Probe]. Cet arrêt s'inscrit dans une suite de jugements impliquant le groupe d'intérêt Energy Probe et d'autres défendeurs. En 1987, une première action avait été présentée afin de déclarer ultra vires du Parlement canadien et contraire à la Charte canadienne des droits et libertés la Loi sur la responsabilité civile nucléaire: Energy Probe c. Canada (P.G.) (1987), 2 C.E.L.R. (N.S.) 304 (H.C.J.), le juge Montgomery.
87. Nous n'entrerons pas ici dans les détails de ce régime particulier de responsabilité et de ses raisons d'être. Il est possible de consulter pour cela Boustany, Katia, La Loi canadienne sur la responsabilité civile nucléaire et les tendances du droit nucléaire (1991) 22 R.G.D. 343.Google Scholar
88. «I would have great difficulty with a proposition that would bring a government policy decision concerning the use of nuclear power within the scope of Section 7. The government was well aware of the inherent risks but, in its wisdom, proceeded with fostering the development of nuclear reactors by enacting the NLA to deal with the economic consequences of the known risks to the public.» Energy Probe, supra note 86 à la p. 731.
89. Notamment par le processus réglementaire dans le cadre duquel le détenteur d'un permis se voit imposer l'obligation d'exploiter l'installation et de l'exploiter de façon sécuritaire. On retrouve les principaux objectifs de sûreté dans les documents de réglementation R-7, R-8 et R-9 ainsi que le document de consultation C-6, publiés par la Commission de contrôle de l'énergie atomique.
90. Energy Probe, supra note 86 au par. 111.
91. «The plaintiffs list a myriad of other issues which they claim involve less safety because of the N.L.A.: backfitting, containment, fuel shift problem, maintenance backlogs, pressure tube problems, seismic hazards, etc. This judgment would become voluminous if I addressed the arguments on both sides of all of the safety concern issues raised by the plaintiffs. I see no point in so doing because I find that the plaintiffs have failed, on a balance of probabilities, to prove that the existence of the N.L.A. has caused less safety in the operation of nuclear reactors which has resulted in increased risk to the public. The inferences that can be drawn from the safety concern examples presented by the plaintiffs are that different decisions by operators of nuclear reactors and the A.E.C.B. may have made nuclear reactors safer thereby decreasing the risk to the public. But, the issue before me is not whether nuclear reactors could be made safer; the issue is, has the N.L.A. caused less safety resulting in an increased risk to the public?» Ibid. au par. 134.
92. Ibid. au par. 148.
93. Voir en particulier Jasanoff, Sheila, «What Judges Should Know About the Sociology of Science» (1992) 32 Jurimetrics Journal 345Google Scholar [ci-après «What Judges Should Know»] qui a été cité, par exemple, dans Schuck, Peter H., «Multi-culturalism Redux: Science, Law and Politics» (1993) 11 Yale Law & Policy Review 1 à la p. 16Google Scholar; «Science and Toxic Torts», supra note 42 à la p. 207; Black, Bert, Ayala, Francisco J. et Saffran-Brinks, Carol, «Science and Law in the Wake of Dauben: A New Search for Scientific Knowledge» (1994) 72 Texas Law Review 715 à la p. 715Google Scholar [ci-après «New Search»].
94. Voir Popper, Karl R., Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, 3e éd., Londres, Routledge & Keegan Paul, 1969Google Scholar; Popper, Karl R., The Logic of Scientific Discovery, New York, Basic, 1959Google Scholar, cité dans «New Search», ibid. aux pp. 754–55.
95. «What Judges Should Know», supra note 93 à la p. 347: «[S]cience is socially constructed. According to a persuasive body of work, the “facts” that scientists present to the rest of the world are not simple reflections of nature; rather, these “facts” are produced by human agency, through the institutions and processes of science, and hence they invariably contain a social component.»
96. Ibid. à la p. 347: «From a sociological viewpoint, scientific claims are never absolutely true but are always contingent on such factors as the experimental or interpretative conventions that have been agreed to within relevant communities of scientists.»
97. Wynne, Brian, «Establishing the Rules of Laws: Constructing Expert Authority» dans Smith, Roger et Wynne, Brian, dir., Expert Evidence: Interpreting Science in the Law, Londres, Routledge, 1989, 23 à la p. 28Google Scholar; «Sociology of scientific knowledge undermines this categorical fact-value distinction and provides a more complex perspective on their interpenetration. In showing that what is agreed as proven fact is ultimately a social achievement among scientists, it admits the role of interests in the construction of “natural knowledge.”»
98. (1993) 125 L.Ed. 2d 469 [ci-après Daubert].
99. Frye c. United States, 293 F. 1013 (D.C. Cir. 1923).
100. Cette règle 702 se lit comme suit: «If scientific, technical, or other specialized knowledge will assist the trier of fact to understand the evidence or to determine a fact in issue, a witness qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training, or education, may testify thereto in the form of an opinion or otherwise.» Voir Daubert, supra note 98 à la p. 480.
101. Voir Daubert, ibid. à la p. 477.
102. Ibid. à la p. 480.
103. Le juge Blackmun explique aussi: «Of course, it would be unreasonable to conclude that the subject of scientific testimony must be “known” to a certainty; arguably there are no certainties in science.» ibid. à la p. 481.
104. Ibid.
105. Ibid. aux pp. 482–83: «Ordinarily, a key question to be answered in determining whether a theory or technique is scientific knowledge that will assist the trier of fact will be whether it can (and has been) tested […] Another pertinent consideration is whether the theory or technique has been subjected to peer review and publication. Publication (which is but one element of peer review) is not a sine qua non of admissibility […] Additionally, in the case of a particular scientific technique, the court ordinarily should consider the known or potential rate of error […] Finally, “general acceptance” can yet have a bearing on the inquiry.»
106. Ibid.
107. Ibid.
108. Ibid. à la p. 481: «[Scientists do not assert that what they know is immutably “true”—they are committed to searching for new, temporary theories to explain, as best they can, phenomena» [tiré d'un mémoire déposé en amicus à l'appui de Merrell Dow].
109. Bert Black, conseiller associé sur le mémoire déposé en amicus à l'appui de Merrell Dow dans l'affaire Daubert par la National Academy of Sciences and l'American Association for the Advancement of Sciences.
110. «Certainty Demon», supra note 44 à la p. 2129.
111. Ibid. àla p. 2131.
112. Ibid. aux pp. 2129–30.
113. «New Search», supra note 93 à la p. 753. Black avait affirmé auparavant que les raisonnements des témoins experts devaient être évalués conformément à la pratique scientifique «Unified Theory», supra note 42, en particulier aux pp. 681–82.
114. «Unified Theory», ibid. à la p. 627: «Where Frye makes acceptance an exclusive test, this Article's proposed approach uses it only when the reasoning underlying an expert's conclusions is called into question.»
115. «New Search», supra note 93 à la p. 776.
116. Brian Stuart Koukoutchos, auteur d'un mémoire en amicus déposé à l'appui de pétitionnaires dans l'affaire Daubert par un groupe disparate de scientifiques comprenant Stephen Jay Gould.
117. Daubert c. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 951 F.2d 1128 (9th Cir. 1991) tel que cité dans Koukoutchos, Brian Stuart, «Solomon Meets Galileo (And Isn't Quite Sure What to Do with Him)» (1994) 15 Cardozo Law Review 2237 à la p. 2238Google Scholar [ci-après «Solomon Meets Galileo»].
118. «Solomon Meets Galileo», ibid. à la p. 2239.
119. Ibid. à la p. 2241.
120. Ibid. à la p. 2243: «I]t is the eventual disappearance of disagreement, rather than its initial absence, that marks a field as a science. And it is, unfortunately but unsurprisingly, precisely in these forefront or developing areas that the courts have the greatest need for expert scientific testimony. Cases in which scientific opinion is unanimous do not often get to trial, or even to the courthouse. In cases that do get that far, disagreement among scientists is likely to be the rule rather than the exception. With respect to disagreements of this sort, the sciences are no different from other fields: the very best people can be mistaken and often are. But whether a litigant's scientific witnesses are right or wrong is a merits question for the jury, not an admissibility question for the judge.»
121. Ibid. à la p. 2244. Noter que Black aussi semble être d'accord sur ce point. Voir «Unified Theory», supra note 42.
122. «Solomon Meets Galileo», supra note 117 à la p. 2246.
123. Ferebee c. Chevron Chemical Co., 736 F.2d 1529 (D.C. Cir. 1984). Voir par exemple «Certainty Demon», supra note 44 à la p. 2129.
124. Ferebee, ibid. à la p. 1536 tel que cité dans Cranor, Cari F., Regulating Toxic Substances, Oxford, Oxford University Press, 1993 à la p. 56.CrossRefGoogle Scholar Voir aussi «Certainty Demon», ibid.
125. «Certainty Demon», ibid. aux pp. 2129–31.
126. «New Search», supra note 93 à la p. 765, n. 318.
127. «Certainty Demon», supra note 44 à la p. 2130.
128. Du moins les raisonnements qui sous-tendent une conclusion dépendent d'un consensus dans la communauté scientifique concernée. Voir «Unified Theory», supra note 42.
129. Ibid. à la p. 604. Sur la manière de séparer les questions de fait scientifiques des questions juridiques ou de politique générale, Black, dans «Unified Theory», ibid. à la p. 613, cite Martin, J. A., «The Proposed “Science Court”» (1977) 75 Michigan Law Review 1058 à la p. 1078.CrossRefGoogle Scholar Dans «Unified Theory», Black ne souscrit pas à la proposition du Pr Martin requérant l'instauration d'une juridiction distincte pour les affaires impliquant la science.
130. «Unified Theory», ibid. à la p. 681.
131. Ibid. à la p. 695.
132. Ibid. à la p. 677.
133. Ibid. aux pp. 677–78: «Some commentators have maintained that for legal purposes, science does not have to be scientific, and that the law can dictate how scientists should reach their conclusions. A recent student Note concludes that “[a]t the heart of the problem presently confronted by the courts in toxic tort suits is the inability to determine causation quantitatively when trans-scientific issues are involved […]” “Trans-science” relates to questions that science cannot answer. Normally, no answer would mean no proof, and plaintiffs would lose. For unspecified reasons, however, the Note assumes that scientists somehow can come up with the needed evidence. It thus calls for a new standard of liability: “The standard must adjust to the inability of trans-science to quantify the effects of a substance. It must also resolve or circumvent the evidentiary and procedural problems resulting from the inherently hypothetical, rather than factual, nature of trans-science.”» Voir aussi ibid. à la p. 695.
134. Il est intéressant de noter qu'un juriste a estimé que la réponse à Black se trouve dans la décision du juge de première instance dans Ferebee: «Product liability law, especially as it relates to relatively new products or those with a relatively rare yet significant danger, would be rendered next to meaningless if a plaintiff could prove he was injured by a product only after a “statistically significant” number of other people were also injured. A civilized legal system does not require that much human sacrifice before it can intervene.» Roisman, Anthony Z., «Conflict Resolution in the Courts: The Role of Science» (1994) 15 Cardozo Law Review 1945 à la p. 1955Google Scholar [ci-après «Conflict Resolution in the Courts»].
135. Cranor, supra note 124.
136. Il faut noter que ces arguments de Black ne sont pas aussi récents que ceux de Black dans «Unified Theory», supra note 42 ou «Certainty Demon», supra note 44.
137. Black, Bert, «Evolving Legal Standards for The Admissibility of Scientific Evidence» (1987) 239 Science 1511 à la p. 1511Google Scholar [ci-après «Evolving Legal Standards»] tel que cité par Cranor, supra note 124 à la p. 62.
138. Cranor, ibid.
139. «Evolving Legal Standards», à la p. 1511 tel que cité par Cranor, ibid. à la p. 63.
140. Cranor, ibid.: «[F]or then a tort law adjudication of the scientific issues merely resembles a science court in disguise.»
141. «Evolving Legal Standards», à la p. 1511 tel que cité par Cranor, ibid.
142. Cranor, ibid.
143. Ibid. à la p. 66, Cranor poursuit:«[F]or my part I am inclined to see the tort system as providing a partial backup or court of last resort, flawed as it is, for the shortcomings of an imperfectly functioning regulatory system and thus would not want to undermine that partial protective role. And […] firms may be more responsive to tort law litigation than to regulatory agencies. Furthermore, if one sees the regulatory system as subject to enormous lobbying pressures on the part of the companies who are the subject of the regulations or as having been in many cases “captured” by them, then this would further weaken the kind of argument that Black presents.»
144. Ibid. Voir aussi les c. 3 et 4.
145. Jasanoff, Sheila et Nelkin, Dorothy, «Science, Technology, and the Limits of Judicial Competence» (1982) 22 Jurimetrics Journal 266 à la p. 274.Google Scholar
146. Ibid.
147. Il est intéressant de remarquer que, même parmi ceux qui clament que le droit et la science ont des «cultures différentes», il y en a qui utilisent cette proposition pour dire que la causalité devrait être déterminée selon la culture scientifique tandis que d'autres insistent pour qu'une traduction de la preuve scientifique en preuve juridique soit effectuée ou que le processus judiciaire supplée la preuve scientifique.
148. «Conflict Resolution in the Courts», supra note 134 à la p. 1955.
149. Lenoble, Jacques et Berten, André, Dire la norme, Paris, L.G.D.J., 1990 à la p. 4.Google Scholar
150. Morin, Edgar, Science avec conscience, Paris, Fayard, 1990 à la p. 37Google Scholar, citant Karl Popper.
151. Ibid. à la p. 38.