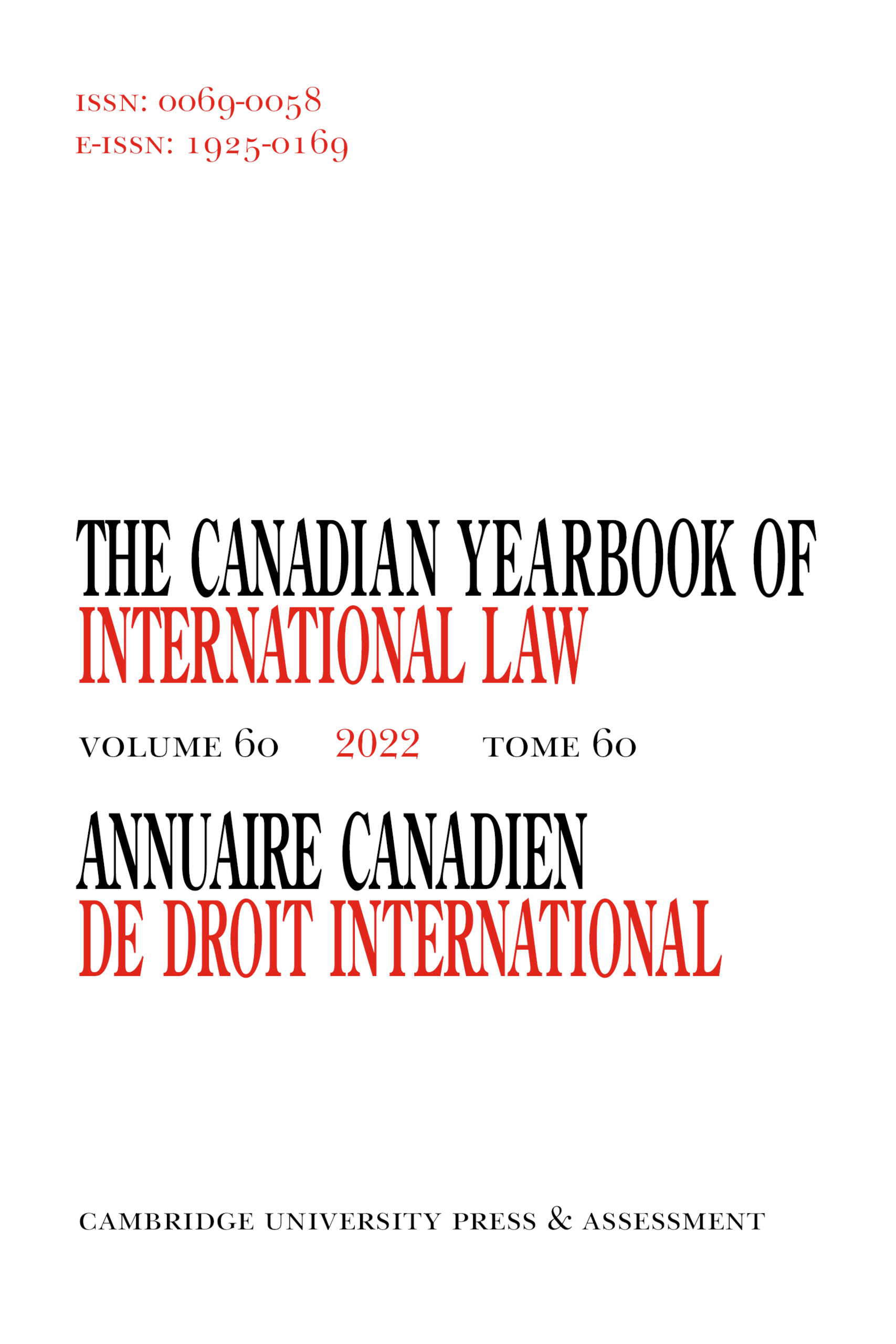No CrossRef data available.
Article contents
Droit et souveraineté à l'aube du XXIe siècle
Published online by Cambridge University Press: 09 March 2016
Abstract
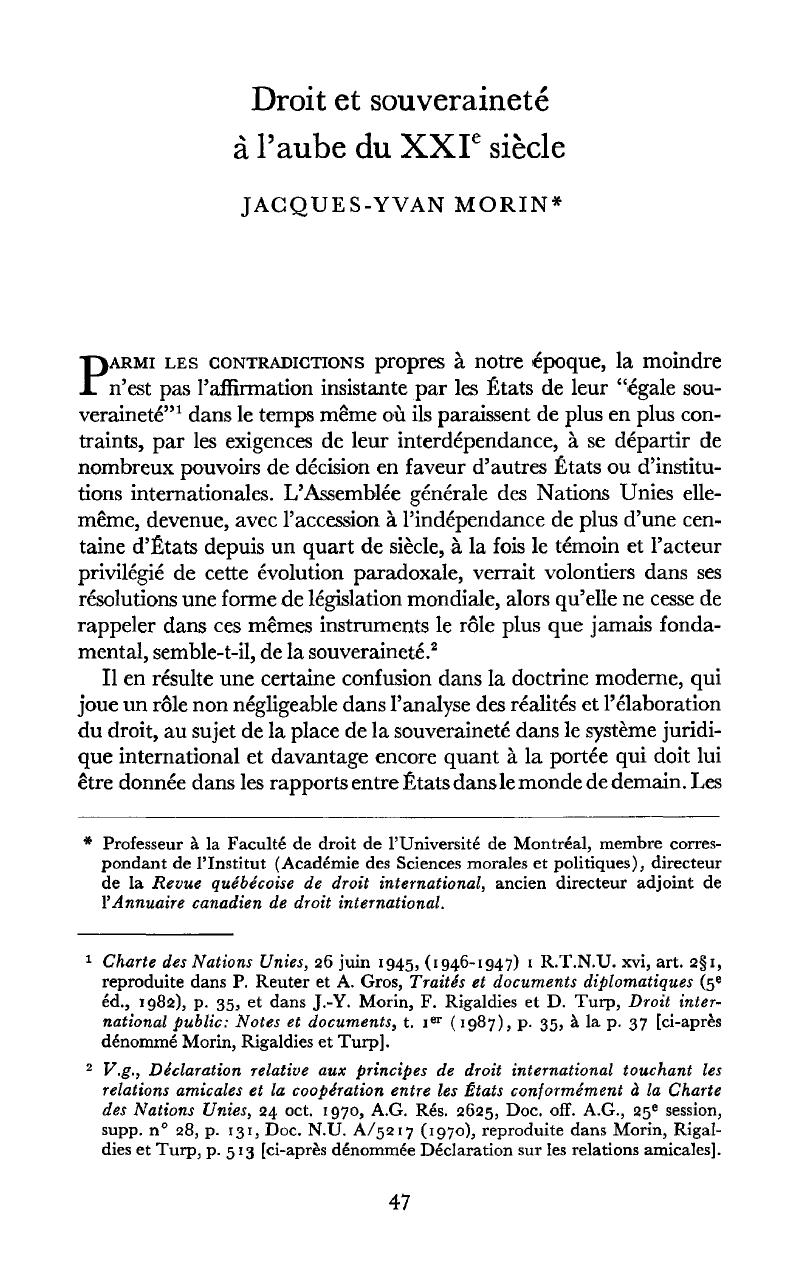
- Type
- Articles
- Information
- Canadian Yearbook of International Law/Annuaire canadien de droit international , Volume 25 , 1988 , pp. 47 - 114
- Copyright
- Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1988
References
1 Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, (1946–1947) 1 R.T.N.U. xvi, art. 2§i, reproduite dans Reuter, P. et Gros, A., Traités et documents diplomatiques (5 e éd., 1982), p. 35,Google Scholar et dans Morin, J.-Y., Rigaldies, F. et Turp, D., Droit international public: Notes et documents, t. 1er (1987), p. 35,Google Scholar à la p. 37 [ci-après dénommé Morin, Rigaldies et Turp].
2 V.g., Déclaration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, 24 oct. 1970, A.G. Rés. 2625, Doc. off. A.G., 25e session, supp. n° 28, p. 131, Doc. N.U. A/5217 (1970), reproduite dans Morin, Rigaldies et Turp, p. 513 [ci-après dénommée Déclaration sur les relations amicales].
3 Brierly, J. L., “The Sovereign State Today,” dans Lauterpacht, H. et Brierly, J. L. (éd.), The Basis of Obligation in International Law (1958), p. 42.Google Scholar L’auteur reconnaît cependant ailleurs que la souveraineté ne saurait être ignorée: voir Brierly, , The Law of Nations (6e éd., 1968), pp. 47–48 Google Scholar.
4 Pinto, R., Le droit des relations internationales (1972), p. 24.Google Scholar Voir également Buchmann, J., À la recherche d’un ordre international (1957), p. 199.Google Scholar
5 Plantey, A., De la politique entre les États: Principes de diplomatie (1987), p. 17.Google Scholar
6 Touscoz, J., “Souveraineté et coopération internationale culturelle, scientifique et technique,” dans Bettati, M., de Bottini, R., Isoart, P., Rideau, J., Sortais, J. P., Touscoz, J. et Zarb, A.-H., La souveraineté au XXe siècle (1971), p. 201,Google Scholar à la p. 214. Voir aussi Brewin, C., “Sovereignty,” dans Mayall, J. (dir.), The Community of States: A Study in International Political Theory (1982), p. 34, aux PP.35, 44, 45:Google Scholar selon cet auteur, la doctrine moderne de la souveraineté, en raison de l’utilité qu’elle présente pour les nouveaux États, connaît un “triomphe universel.” Des points de vue semblables ou voisins sont souvent exprimés par les internationalistes du Tiers-Monde: voir notamment Anand, R.P., “Sovereign Equality of States in International Law,” (1986) 197 R.C.A.D.I. 9, aux pp. 40, 49 et 189Google Scholar; Prakash Sinha, S., “Perspective of the Newly Independent States on the Binding Quality of International Law,” dans Snyder, F.E. et Sathirathay, S. (dir.), Third World Attitudes Toward International Law (1987) 23, à la p. 28 Google Scholar; Pal, D., State Sovereignty at the Cross-Roads (1962), pp. 152 et ss., 197.Google Scholar
7 Bodin, J., Les six livres de la République (1576; éd. 1580), pp. 91, 95Google Scholar. Dans l’édition anglaise (The Six Books of a Commonweale, 1606; éd. McRae, 1962), l’expression “loix communes à tous peuples” a été rendue par “Laws of nations” (p. 90). Voir Touchard, J., Histoire des idées politiques (8 e éd., 1985), t. Ier, pp. 286–93Google Scholar; Delbrueck, J., “International Protection of Human Rights and State Sovereignty,” dans Snyder, et Sathirathay, , op. cit. supra, note 6, pp. 263, 265.Google Scholar
8 Hobbes, T., Leviathan or the Matter, Forms and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civil (1651; éd. Oakeshott, 1957), pp. 117, 129, 132Google Scholar. Voir Polin, R., Politique et philosophie chez Thomas Hobbes (1953), pp. 77, 88, 202Google Scholar.
9 Obligation rappelée récemment avec force par la Cour internationale de Justice dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, Arrêt C.I.J. Recueil, 1986, p. 13, à la p. 147.
10 Id., p. 146.
11 La règle coutumière Pacta sunt servanda est maintenant inscrite et “codifiée” dans la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), [1980] R.T. Can. n° 37, art. 26, reproduit dans Morin, Rigaides et Turp, p. 225.
12 Sentence arbitrale rendue le 4 avril iga8 par M. Max Huber, entre les États-Unis et les Pays-Bas, dans le litige relatif à la souveraineté sur l’île de Palmas (ou Miangas), 2 R.S.A. 829, à la p. 839 (C.P.A.); traduction française (non officielle) dans (1935) 42 R.G.D.I.P. 156, reproduite dans Morin, Rigaldies et Turp, p. 569; voir également Détroit de Corfou, fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 4, à la p. 23, reproduit dans Morin, Rigaldies et Turp, à la p. 631.
13 Grotius, H., Le droit de la guerre et de la paix (De jure belli ac pacis libri tres, 1625; trad. Barbeyrac, 3e éd., 1746)Google Scholar.
14 Id., t. Ier, p. 120.
15 Id., pp. 202 et ss., 220.
16 de Vattel, E., Le droit des gens ou principes de la loi naturelle (1758; éd. de 1835) t.Ier, p. 168.Google Scholar
17 Hegel, G.W.F., Grundlinien des Philosophie des Rechts (1821; traduction A. Kaan, 1940), §§ 333–334 Google Scholar, reproduits dans Königson, M.-J., Hegel: Le droit, la morale et la politique (1977), p. 177 Google Scholar; Philosophie des Rechts (1819–1830; éd. D. Heinrich, 1983), p. 279: “Es gibt zwischen den Staaten keinen Prätor.” Voir Touchard, op. cit. supra, note 7, t. 3, p. 504.
18 Jellinek, G., Allgemeine Staatslehre (1905; 3e éd., 1960), pp. 25 et ss.Google Scholar
19 Triepel, H., Völkerrecht und Landesrecht (1899), p. 6 Google Scholar; “Les rapports entre le droit interne et le droit international,” (1923) 1 R.C.A.D.I. 73, aux pp. 82 et 83. La Vereinbarung signifie “une véritable union de volonté,” laquelle doit être distinguée des “contrats.”
20 Hänel, A., Studien zum deutschen Staatsrechte (1873–1888), t. Ier pp. 149 et ss.Google Scholar
21 Austin, J., The Province of Jurisprudence Determined (1832, éd. 1968), pp. 142, 201.Google Scholar
22 Voir notamment Decencière-Ferrandière, A., “Considération sur le droit international dans ses rapports avec le droit de l’État,” (1933) 40 R.G.D.I.P. 45, à la p. 64.Google Scholar
23 Pacte de la Société des nations, 1919, reproduit dans Reuter et Gros, op. cit. supra, note 1, p. 27; Protocole de la signature concernant le Statut de la Cour permanente de Justice internationale, 16 déc. 1920, (1921) 6 R.T.S.D.N. 379, à la p. 390 ; Constitution de l’Organisation internationale du travail, révisée le 9 oct. 1946, (1948) R.T.N.U. 34, reproduite dans Morin, Rigaldies et Turp, p. 75 [ci-après dénommée Constitution de l’O.I.T.].
24 Kelsen, H., Pure Theory of Law (Reine Rechtslehre, 1934, trad. Knight, 1967), p. 324 Google Scholar; “Les rapports de système entre le droit interne et le droit international,” (1926) 14 R.C.A.D.I. 225, à la p. 303.
25 Scelle, G., Précis de droit des gens: Principes et systématique (1932–34), t. Ier, p. 31 Google Scholar; Droit international public (1944), pp. 20 et 21 ; l’auteur en conclut que “l’État ne peut pas être souverain.” Voir également, dans le même esprit, Politis, N., Les nouvelles tendances du droit international (1927), pp. 23 et ss.Google Scholar; Sukiennicki, W., La souveraineté des États en droit international moderne (1927), pp. 55, 87, 388Google Scholar.
26 Précis, supra, note 25, t. Ier, pp. 43, 47. Voir Kasirer, N., “A Reading of Georges Scelle’s Précis de droit des gens,” (1986) 24 A.C.D.I. 372, à la p. 381.Google Scholar J. Buchmann, op. cit. supra, note 4, p. 196, voit dans le dédoublement fonctionnel “l’ersatz, et l’ersatz dangereuse, de l’organisation institutionnelle défaillante.”
27 Principles of International Law (2e éd., 1966), p. 583.
28 Voir Krylov, S.B., “Les notions principales du droit des gens (La doctrine soviétique du droit international),” (1947) 70 R.C.A.D.I. 407, à la p. 451 Google Scholar: l’auteur s’en prend aux “zélateurs de la Société des Nations,” Kelsen, H. et Politis, N.. Voir également Vychinski, A.J., “Mezdunarodnoye Pravo i Mezdu-narodnoya Organizaciya” (Droit international et organisation internationale), (1948) Sovetskoye Gogudarstvo i Pravo 473 Google Scholar; Levine, I.D., Suverenitet (1948), p. 112.Google Scholar
29 Sur l’évolution antérieure, voir Calvez, J.-Y., Droit international et souveraineté en U.R.S.S. (1953), pp. 43–141 Google Scholar; Lapenna, I., Conceptions soviétiques de droit international public (1954), pp. 63–122.Google Scholar
30 Droit international public: Problèmes théoriques (1965), pp. 80, 92.
31 Traité de droit international (1883), t. Ier, pp. 15, 19.
32 Op. cit. supra, note 30, p. 151.
33 Id., p. 152.
34 Id., p. 150. La pratique soviétique cependant est sensible à la conjoncture. Si M. Tunkin a pu soutenir que les principes de la souveraineté et de la non-intervention s’appliquent dans les rapports entre États socialistes (op. cit. supra, note 30, à la p. 244), les événements de Tchécoslovaquie (août 1968) ont donné naissance à la doctrine de la souveraineté limitée, dite “Doctrine Brejnev,” qui fait un devoir aux pays de l’Europe de l’Est et à l’U.R.S.S. de défendre le modèle commun de socialisme, au besoin contre les déviations d’un parti frère. Voir la lettre du 16 juillet 1968 adressée au Parti communiste tchécoslovaque par les Partis de l’U.R.S.S., de l’Allemagne de l’Est, de la Hongrie, de la Bulgarie et de la Pologne, dans Facts on File Yearbook 1968, vol. 28, p. 283. À Budapest, le 17 nov. 1968, M. Brejnev qualifia l’invasion de la Tchécoslovaquie de “mesure extraordinaire dictée par la nécessité”: id., p. 485. Voir aussi Charvin, C., Les États socialistes aux Nations Unies (1970), p. 76.Google Scholar
35 Préface à l’ouvrage de G. I. Tunkin, op. cit. supra, note 30, à la p. 12.
36 Id., pp. 80, 87.
37 Anzilotti, D., Cours de droit international (1929), t. Ier, p. 51.Google Scholar
38 G.I. Tunkin, op. cit. supra, note 30, p. 150.
39 Id.,p. 152.
40 Lotus, arrêt n° 9, 1927, C.P.J.I. série A n° 10, reproduit dans Morin, Rigaldies et Turp, p. 587, à la p. 593.
41 Communiqué final, 24 avril 1955, par. F, reproduit dans Stern, B., Un nouvel ordre économique international? (1983), vol. 1, pp. 392, 395 [ci-après dénommé Stern]Google Scholar. Voir Guitard, O., Bandoeng et le réveil des peuples colonùés (1962), pp. 44 et ss.Google Scholar
42 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, du 10 déc. 198a, Doc. N.U. A/Conf. 62/188 et Corr. 1 à 11 (198a), art. 55 à 75, reproduite dans Morin, Rigaldies et Turp, pp. 273, 889 [ci-après dénommée Convention sur le droit de la mer]. La Convention n’est pas encore entrée en vigueur, n’ayant fait l’objet jusqu’ici que d’une trentaine de ratifications sur les 60 exigées par l’art. 308 de la Convention. Cependant, en raison de la pratique des États, la Cour internationale de Justice a estimé que la zone économique exclusive peut être considérée “comme faisant partie du droit international moderne”: Plateau continental (Tunisie/Jamahriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, p. 18, à la p. 74.
43 Comp. Convention sur la haute mer, 29 avril 1958, (1963) 450 R.T.N.U. 83; Convention sur le plateau continental, même date, (1964) 499 R.T.N.U. 312; Convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer, même date, (1966) 559 R.T.N.U. 285.
44 Convention sur le droit de la mer, supra, note 42, art. 133 à 173.
45 La contradiction est soulignée par Nigoul, C. et Torrelli, M., Les mystifications du nouvel ordre international (1984), pp. 55–56 Google Scholar. Voir également Nguyen Quoc, D., Daillier, P. et Pellet, A., Droit international public, (3e éd., 1987), pp. 998 et ss.Google Scholar
46 Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux, 14 déc. 1960, A.G. Rés. 1514, Doc. off. A.G., 15e session, supp. n° 16, p. 70, Doc. N.U. A/4684 (1960), par. 6, reproduit dans Morin, Rigaldies et Turp, pp. 505, 507 (ci-après dénommée Declaration sur l’indépendance).
47 Développement économique des pays insuffisamment développés, 4 déc. 1948, A.G. Rés. 198 (III), Doc. off. A.G., 3e session, 1re partie, p. 37, Doc. N.U. A/810 (1948), reproduite dans Stern, p. 165.
48 Communiqué, supra, note 41, par. A, § 12, reproduit dans Stern, p. 393.
49 Voir l’annexe à l’Acte final de la Conférence de Genève sur le commerce et le développement, 23 mars-6 juin 1964, dans Keesing’s Contemporary Archives (1965–1966), vol. XV, p. 20583. Le “Groupe des 77” comptait 127 États membres au moment de la VIIe C.N.U.C.E.D. (juil. 1987).
50 Adoptée à la 1re réunion ministérielle du Groupe des 77, 24 oct. 1967, reproduite dans Stern, p. 409.
51 Déclaration concernant l’instauration d’un nouvel ordre économique international, 1er mai 1974, A.G. Rés. 3201 (S-VI), Doc. off. A.G., 6e session extra-ordinaire, supp n° 1, p. 3, Doc. N.U. A/9559 (1974), reproduite dans Stern, p. 3 [ci-après dénommée Déclaration sur le n.o.é.i.] ; Programme d’action concernant l’instauration d’un nouvel ordre économique international, 1er mai 1974, A.G. Rés. 3202 (S-VI), id., p. 5, reproduit dans id., p. 6 [ci-après dénommé Programme d’action]; Charte des droits et devoirs économiques des États, 12 déc. 1974, A.G. Rés. 3281, Doc. off. A.G., 29e session, supp. n° 31, p. 5, Doc. N.U. A/9631 (1976), reproduite dans Morin, Rigaldies et Turp, p. 523 [ci-après dénommée Charte des droits]. Sur la portée de ces “documents concertés,” voir Bastid, S., “Le droit international de 1955 à 1985,” (1984) 30 A.F.D.I. 9, à la p. 18.Google Scholar
52 Déclaration, supra, note 51, préambule.
53 Id., par. 4.
54 Programme, supra, note 51, par I, §§ 1 et a; par. II, § 1 ; par. III.
55 Déclaration sur la souveraineté permanente sur les richesses naturelles, 14 déc. 1962, A.G. Rés. 1803, Doc. off. A.G., 17e session, supp. n° 9, p. 17, Doc. N.U. A/5309 (1962), reproduite dans Morin, Rigaldies et Turp., p. 509 [ci-après dénommée Déclaration sur la souveraineté].
56 Charte de droits, supra, note 51, art. 2 §2C Cependant, la Déclaration, supra, note 55, prescrivait “une indemnisation adéquate, conformément aux règles en vigueur dans l’État qui prend ces mesures dans l’exercice de sa souveraineté et en conformité du droit international” (par. I §4).
57 Id., art. 2 §2a) et art. 19.
58 Protocole modifiant l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, 8 fév. 1965, (1965) 572 R.T.N.U. 321, art. XXXVI et ss., reproduits dans Morin, Rigaldies et Turp, pp. 95, 107. Voir Jouanneau, D., Le GATT (1980), pp. 102–120.Google Scholar
59 Pellet, A., Le droit international du développement (2e éd., 1987), p. 42.Google Scholar
60 Certains États membres souhaitent notamment introduire dans la Charte de l’ONU le principe selon lequel les résolutions adoptées par consensus ou à l’unanimité “constituent des engagements fermes” : voir Rapport du Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l’Organisation, Doc. A.G., 35e session, supp. n° 33, p. 62, Doc. N.U. A/35/33 (1980). Récemment, au même Comité, une proposition franco-britannique avançait l’idée que les résolutions de l’Assemblée générale devraient, dans la mesure du possible, être adoptées par consensus, après consultation, en vue de les rendre plus acceptables et plus facilement suivies d’effets, mais des pays en développement ont laissé entendre qu’une telle méthode n’était pas souhaitable si les résolutions se trouvaient vidées de leur substance: id., 41e session, supp. n° 33, pp. 11, 13, Doc. N.U. A/41/33 (1986). Certains internationalistes du Tiers-Monde estiment que de nouveaux mécanismes d’élaboration du droit sont requis, la coutume étant inadaptée aux changements requis et le traité plaçant les pays en développement dans une situation d’inégalité pour négocier. Or, la résolution est apparue, grâce à leur nombre, comme “un droit de créa-tion du droit” : la formation spontanée de la coutume en découle et les résolutions ont “valeur nécessairement normative pour l’avenir.” Voir Bedjaoui, M., Pour un nouvel ordre économique international (UNESCO, 1979), pp. 135, 140, 143 et 182.Google Scholar
61 V.g., Reuter, P. et Combacau, J., Institutions et relations internationales (3 e éd., 1985), p. 331 Google Scholar; Colliard, C.-A., Institutions des relations internationales (8e éd., 1985), p. 421 Google Scholar; Nguyen Quoc, Daillier et Pellet, op. cit. supra, note 45, p. 341.
62 Stratégie internationale du développement pour la deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement, 24 oct. 1970, A.G. Rés. 2626, Doc. off. A.G., 25e session, supp. n° 28, p. 43, Doc. N.U. A/8022 (1971) [ci-après dénommée la Stratégie II]; Stratégie . .. pour la troisième Décennie ..., 5 déc. 1980, A.G. Rés. 35/56; Doc. off. A.G., 35e session, supp. n° 48, p. 123, Doc. N.U. A/35/48 (1951); ces deux résolutions sont reproduites dans Stern, pp. 210 et 340.
63 “Droit déclaratoire et droit programmatoire : de la coutume sauvage à la ‘soft law’,” dans S.F.D.I., L’élaboration du droit international public (Colloque de Toulouse, 1975), pp. 132, 136 et ss.
64 Id., p. 138.
65 Déclaration sur l’indépendance, supra, note 46. Il y eut 89 voix en faveur. S’abstinrent: le Portugal, l’Espagne, l’Afrique du Sud, le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Australie, la Belgique, la République Dominicaine et la France: voir Stern, p. 171.
66 Déclaration sur la souveraineté, supra, note 55. Il y eut 87 voix en faveur. Les États socialistes s’abstinrent tandis que l’Afrique du Sud et la France votèrent contre: voir Stem, op. ct. supra, note 41, p. 180.
67 Id., par. I, §4; voir supra, note 56.
68 Charte des droits, supra, note 51. Il y eut 100 voix en faveur. Votèrent contre: la Belgique, le Danemark, les États-Unis, le Luxembourg, le Royaume-Uni et la République Fédérale Allemande; s’abstinrent: l’Autrice, le Canada, la France, l’Irlande, l’Israël, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège et l’Espagne. Voir Stem, p. 63.
69 Arrêt, C.I.J. Recueil 196g, pp. 3,43.
70 Cf. Statut de la Cour internationale de Justice, 26 juin 1945, (1946–47) 1 R.T.N.U. xvi, [1945] R.T. Can. n° 7, art. 38§1b), reproduit dans Morin, Rigaldies et Turp, pp. 61, 69.
71 California Asiatic OU Company et Texaco Overseas Petroleum Company c. Gouvernement de la République Arabe Libyenne, (1977) 104 J.D.I. 350, par. 83 et ss., reproduite dans Morin, Rigaldies et Turp, p. 857, aux pp. 887 et ss. [ci-après dénommée la Sentence Texaco].
72 Supra, note 51.
73 Sentence Texaco, supra, note 71, par. 86, al. 5, dans Morin, Rigaldies et Turp, p. 890.
74 Pour le détail du vote et des abstentions, voir supra, note 68.
75 Déclaration, supra, note 55.
76 Id., dans Morin, Rigaldies et Turp, aux pp. 888, 890. Pour le détail du vote et des abstentions, voir supra, note 66. Les pays socialistes s’étaient abstenus, mais l’arbitre a sans doute estimé qu’ils n’étaient pas en cause.
77 Virally, M., “Conclusions du Colloque,” dans S.F.D.I., Pays en voie de développement et transformation du droit international (Colloque d’Aix-en-Provence, 1974), P. 309 Google Scholar; R.-J- Dupuy, loc. cit. supra, note 63, p. 146.
78 Supra, notes 51 et 61.
79 Voir Virally, M., “La deuxième décennie des Nations Unies pour le développement: Essai d’interprétation parajuridique,” (1970) 16 A.F.D.I. 9.Google Scholar
80 “Les Nations Unies et le droit international économique: Rapport introductif,” dans S.F.D.I., Les Nations Unies et le droit international économique (Colloque de Nice, 1986), pp. 3,61.
81 Voir Stern, pp. 14–56.
82 Id., pp. 20, 50.
83 Supra, note 11, art. 53. Voir Reuter, P., Introduction au droit des traités (1972), pp. 138, 143.Google Scholar
84 Op. cit. supra, note 25, t. II, pp. 20 et ss.
85 Rapports de la Commission sur les traveaux de ses 17e et 18e sessions, Doc. off. A.G. 21e session, supp. n° 9, p. 81, Doc. N.U. A/6309/Rév. 1 (1966).
86 Sentence Texaco dans Morin, Rigaldies et Turp, p. 884. Voir également la Sentence arbitrale du 24 mars 1982 (Aminoti c. Koweit), (1982) 109 J.D.I. 869, à la p. 893, où l’arbitre P. Reuter écarte la prétention du défendeur selon laquelle la souveraineté permanente sur les ressources naturelles est devenue une règle de jus cogens, empêchant les États d’accorder, par contrat ou par traité, des garanties de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’exercice de l’autorité publique à l’égard des richesses naturelles.
87 Supra, note 11, art. 64.
88 Id., art. 66, qui ajoute: “à moins que les parties ne décident d’un commun accord de soumettre le différend à l’arbitrage.”
89 Déclaration sur les relations amicales, supra, note 2, dans Morin, Rigaldies et Turp, pp. 513-521, passim. Sur la contradiction latente entre le nouvel ordre économique international et la souveraineté, voir Bernier, I., “Souveraineté et interdépendance dans le nouvel ordre économique international,” dans Macdonald, R. St J., Johnston, D.M. et Morris, G.L. (dir.), The International Law and Policy of Human Welfare (1978), pp. 425, 427, 438, 444.Google Scholar
90 Déclaration sur le n.o.é.i., supra, note 51, préambule et par. 4a) ; Programme d’action, supra, note 51, introduction et par. VIII a); Charte des droits, supra, note 51, préambule, chap. Ier, chap. II, art. k et 2, voir Touscoz, loc. cit. supra, note 80, p. 58; Nigoul et Torrelli, op. cit. supra, note 45, p. 54.
91 Voir Feuer, G., “Les principes fondamentaux du droit international du développement,” op. cit. supra, note 77, pp. 191, 204 et ss.Google Scholar; Ligot, M., Les accords de coopération entre la France et les États africains et malgache d’expression française (1964).Google Scholar
92 V.g., Échange de notes constituant un accord d’assistance économique et technique entre les États-Unis d’Amérique et le Mali, 4 janv. 1961, (1961) 405 R.T.N.U. 169, art. 2; Accord de coopération économique et technique entre le gouvernement de l’U.R.S.S. et la République de Zambie, 26 mai 1967, (1967) 643 R.T.N.U. 194, art. 3, 8 et 10.
93 Voir Luchaire, F., Droit d’outre-mer et de la coopération (2 e éd., 1966), pp. 465–72, 486 et ss.Google Scholar
94 Déclaration sur la souveraineté, supra, note 55, par II, §6, et par III.
95 Voir notamment la Déclaration sur les relations amicales, supra, note 2, sub tit. “Le devoir des États de coopérer les uns avec les autres conformément à la Charte.”
96 Charte des droits, supra, note 51, art. 1er.
97 Stratégie II, supra, note 62, par. 45 et 46.
98 Sur les difficultés rencontrées par ces projets, voir Financement du développement économique, 14 déc. 1957, A.G. Rés. 1219, Doc. off. A.G., 12e session, supp. n° 18, p. 15, Doc. N.U. A/3805 (1958); Fonds d’équipement des Nations Unies, 14 déc. 1971, A.G. Rés. 2812, Doc. off. A.G., 26e session, supp. n° 29, p. 62, Doc. N.U. A/2812 (1971); C.E.S., Rés. 1020, 11 août 1964, Doc. off. C.E.S. 37e session, supp. n° 1, p. 20, Doc. N.U. E/3970 (1965).
99 Voir Exposé de la position du Groupe des Soixante-Dix-Sept sur les problèmes financiers et monétaires: le développement mondial en crue, dans Actes de la C.N.U.C.E.D., 6e session (Belgrade, 1983), vol. I, pp. 136, 138 (reconstitution des avoirs du F.I.D.A.) et p. 11 (situation du Fonds commun) [ci-après dénommé Exposé].
100 Fusion du Fonds spécial et du Programme élargi d’assistance technique en un Programme des Nations Unies pour le développement, 22 nov. 1965, A.G. Rés. 2029, Doc. off. A.G. 20e session, supp. n° 14, p. 20, Doc. N.U. A/6014 (1966). Sur l’état du P.N.U.D., voir l’Exposé, supra, note 99, p. 138.
101 Voir A. Pellet, op. cit. supra, note 59, p. 74.
102 Voir Carreau, D., “Chronique de droit international économique: Monnaie,” (1985) 31 A.F.D.I. 689, à la p. 703.Google Scholar Le directeur général du F.M.I, a jugé opportun de justifier la démarche de l’organisme en publiant un opuscule intitulé “Le fonds impose-t-il l’austérité?” Quin 1984), dans lequel il explique que les coûts sociaux découlant du programme de redressement sont inéluctables, mais qu’il n’appartient pas au Fonds d’en effectuer la répartition entre les diverses couches de la société; ces choix sont politiques et relèvent “de la souveraineté des États membres” et le F.M.I. “ne saurait avoir pour vocation de dicter à des gouvernements le choix de leurs objectifs sociaux et politiques.” Il n’en reste pas moins, comme le fait observer D. Carreau, que la frontière entre les paramètres macro-économiques, qui sont les seuls auxquels le Fonds s’intéresse en principe, et les politiques internes, n’est pas facile à tracer: “Chronique de droit international économique,” (1984) 30 A.F.D.I. 744, à la p. 795.
103 O.C.D.E., Coopération pour développement: Efforts et politiques poursuivis par les membres du Comité d’aide au développement, Rapport 1986 de J. C. Wheeler, président du C.A.D. (1987), p. 56.
104 Id., pp. 137, 141 et 14a.
105 Id., p. 146.
106 Id., p. 145.
107 Id., pp. 147–48.
108 Id., pp. 139, 148.
109 La Convention de Yaoundé II — L’association des pays et territoires d’outremer à la CEE — Textes annexes (Commission des Communautés européennes, 1969); Convention ACP-CEE de Lomé, 28 fév. 1975, J.O.C.E., 30 janv. 1976, Législation n° L. 25, p. 2 et dans Le Courrier CE-ACP, n° 31 (mars 1975) p. 1; Deuxième Convention ACP-CEE signée à Lomé le 31 oct. 1974, dans Le Courrier ACP-CE, n° 58 (nov. 1979), p. 1; Conseil des Ministres ACP-CEE, Troisième Convention ACP-CEE signée à Lomé le 8 déc. 1984 et documents connexes (1985) [ci-après dénommée Lomé III] reproduite dans Le Courrier ACP-CÊE, n° 85 (janv.-fév. 1985), p. 1 et dans (1985) 4 D.J.I. 40.
110 Roy, M.P., La CEE et le Tiers-Monde: Les conventions de Lomé (1985), p. 142.Google Scholar
111 Le commerce entre la C.É.E. et les États A.C.P. a connu une croissance considérable entre 1970 et 1980, mais l’importance relative de ces pays parmi les fournisseurs de la Communauté a diminué progressivement durant cette période par rapport aux importations en provenance des autres pays, de sorte que les préférences douanières n’ont pas rencontré tous les succès escomptés. La part des A.C.P. dans le commerce mondial a chuté dramatiquement entre 1970 et 1981 — de 3,5% à 2,8% — au point que “l’on peut craindre une exclusion progressive des pays A.C.P., et de l’Afrique en particulier, du système économique mondial.” Voir Roy, op. cit. supra, note 110, pp. 22–25.
112 Voir Gueye, D.M., “Le point vue des États associés,” dans Le renouvellement de la Convention de Yaoundé (1969), p. 53, à la p. 62.Google Scholar
113 Roy, op. cit. supra, note 110, p. 137.
114 Lomé III, supra, note 109, préambule et art. 3.
115 Id., art. 22 à 24.
116 Roy, op. cit. supra, note 110, pp. 138, 144.
117 Lomé III, supra, note 109, art. 215.
118 Mémorandum sur la politique communautaire de développement (sept. 1982), dans CÉE, Commission, Communications présentées au Conseil le 27 juil. 1971 et le 2 fév. 1972 (1972).
119 Roy, op. cit. supra, note 110, p. 139, n. 6.
120 Lomé III, supra, note 109, art. 117 et 219.
121 Id., art. 220, al. 7. Pour les projets qui font appel au F.E.D., qui est alimenté à même les budgets des États membres, le Comité du Fonds, composé d’experts délégués par ceux-ci, exerce “un droit de regard” et doit auparavant donner son avis sur “la qualité et l’opportunité” de chaque projet. La procédure prévoit une pondération des voix établie en fonction de la contribution de chaque État, qui empêche l’un ou l’autre des principaux États pouvoyeurs d’emporter seul la décision. Voir Roy, op. cit. supra, note 110, p. 140, n. 8.
122 Lomé III, art. 225 à 238. À ces textes, il faut ajouter les 72 articles du Règlement financier de la Commission et les 142 portant sur les conditions générales des contrats.
123 V.g., le Soudan (1%), la Papouasie-Nouvelle-Guinée (4%), l’île Maurice (6%), le Zaïre (17%), etc. Voir C.É.E., Cour des comptes, Rapport annuel relatif à l’exercice 1980, p. 148–152; id., 1983, p. 122 et ss.
124 Lomé III, supra, note 109, art. 193.
125 Voirie Courrier ACP-CÊE, n° 80 (juil. 1983), p. 79.
126 Roy, op. cit. supra, note 109, p. 136.
127 Voir notamment de la Serre, F., “La C.É.E. et le dialogue Nord-Sud,” dans Le Tiers Monde et la C.Ê.E. (Assoc. franc, pour l’étude du Tiers Monde, 1978), p. 223, à la p. 229Google Scholar; Coppens, H., Faber, G. et Lof, E., “European Community’s Security of Supply with Raw Materials and the Interests of Developing Countries : The Need for a Cooperative Strategy,” dans Alting von Geusau, F.A.M. (dir.), The Lomé Convention and the New International Economic Order (1977) p. 161, à la p. 180Google Scholar; Boardman, R., Shaw, T.M. et Soldâtes, P., Europe, Africa and Lomé III (1985), p. 31 Google Scholar; La Convention de Lomé: Néo-colonialisme ou nouvel ordre économique international? (C.G.T., 1977), pp. 38, 50 et ss.
128 Bettati, M., “Les limites de la Convention de Lomé,” dans Le Tiers-Monde et la C.Ê.E., supra, note 127, à la p. 110 Google Scholar; Bourrinet, J., La coopération économique eurafricaine (1976), pp. 159, 174, 182Google Scholar; Bouvier, P., L’Europe et la coopération au développement: Un bilan—la Convention de Lomé (1980), p. 41 Google Scholar; sur la situation antérieure aux Conventions de Lomé, voir Torrelli, M. et Valaskakis, K., L’Association C.É.E.: Afrique noire — un phénomène de domination? (C.R.D.E., 1973, multigr.), p. 434.Google Scholar
129 Traité sur les principes régissant l’activité des États dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique y compris la lune et les corps célestes, 27 janv. 1967, (1967) 610 R.T.N.U. 205, [1967] R.T. Can. n° 19; Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, 1er juil. 1968, (1970) 719 R.T.N.U. 161, [1970] R.T. Can. n° 7, reproduits dans Morin, Rigaldies et Turp, pp. 205 et 211.
130 The Changing Structure of International Law (1964), pp. 152–87. Dans le même sens, Virally, M., “Sur un pont aux ânes : les rapports entre droit inter-national et droits internes,” dans Mélanges Henri Rolin — Problèmes de droit des gens (1964), pp. 488, 504Google Scholar: “II n’est désormais plus de domaine où le droit international n’ait pénétré ou ne puisse pénétrer.”
131 Statut de la Commission des droit international, Doc. N.U. A/CN. 4/4/Rev. 2, art. 15 à 24.
132 Des auteurs ont souligné “l’élargissement” du droit international par son extension constante à nouveaux objets et son expansion géographique con-comitante: voir W. Friedman, op. cit. supra, note 130, pp. 64, 71; B. V. A. Röling, International Law in an Expanded World (1960), pp. xv, 16.
133 Supra, note 23.
134 Voir Zarb, A.H., “Souveraineté et institutions spécialisées des Nations Unies,” dans Bettati, , de Bottini, , Isoart, , Sortais, , Touscoz, et Zarb, , op. cit. supra, note 6, pp. 235, 261.Google Scholar
135 Constitution de l’O.I.T., supra, note 23, art. 3 et 4.
136 Id., art. 19 §2. Voir Béguin, B., Le tripartisme dans l’O.I.T. (1959).Google Scholar
137 Id., art. 19 §5.
138 Id., art. 19 §5e); la même obligation s’applique aux recommandations: id., art. 19 §5.
139 Échange des populations grecques et turques, avis consultatif, 1928, C.P.J.I. série B, n° 10, p. 20.
140 Constitution de I’O.I.T., supra, note 23, art. 26–29. Voir aussi la procédure particulière à la violation des la liberté syndicale et la “jurisprudence” du Comité de la liberté syndicale, décrites et rapportées dans Bureau International du Travail, Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du B.I.T. (3e éd., 1985).
141 Id., art. 29–34.
142 C’est également la conclusion de Colliard, op. cit. supra, note 61, p. 669.
143 Constitution de l’O.I.T., supra, note 23, art. 36. Cette majorité doit cependant comprendre cinq des dix États membres représentés au Conseil d’ad-ministration en qualité de membres ayant l’importance industrielle la plus grande.
144 Charte, supra, note 1,art. 108.
145 Traité portant interdiction des essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau, 5 août 1963, (1963) 480 R.N.T.U. 93, [1964] R.T. Can. n° 1, reproduit dans Morin, Rigaldies et Turp, p. 155: la ratification par la majorité des Parties suffit, y compris cependant toutes les Parties originellement signataires (art. II §a).
146 Nguyen Quoc, Daillier et Pellet, op. cit. supra, note 45, p. 273.
147 Loc. cit. supra, note 134, p. 263.
148 Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, (1948) 14 R.T.N.U. 195 [ci-après dénommée Constitution de 1O.M.S.]; Convention relative à l’aviation civile internationale, 7 déc. 1944, (1948) 15 R.T.N.U. 295, [1947] R.T. Can. n° 36 [ci-après dénommée la Convention de Chicago], complétée par l’Accord relatif au transit des services aériens internationaux, 7 déc. 1944, (1951) 84 R.T.N.U. 389, et l’Accord relatif au transport aérien international, 7 déc. 1944, (1953) 171 R.T.N.U. 387, reproduits dans Morin, Rigaldies et Turp, pp. 11, 28 et 30.
149 Constitution de l’O.M.S., supra, note 148, art. 31.
150 Cité dans Colliard, op. cit. supra, note 61, p. 676.
151 Ibid.
152 Reuter et Combacau, op. cit. supra, note 61, p. 193.
153 O.M.S., Règlement n° 2 (1951), art. 106, Actes officiels de l’O.M.S., n° 37 (1952), p. 335. Ce Règlement a été l’objet de 73 réserves émises par 25 États au moment de son adoption. Voir Colliard, op. cit. supra, note 61, p. 676. La disposition de 1951 a été remplacée par le R.S.I. (1969), art. 87, Actes officiels de l’O.M.S., n° 176 (1969), p. 37, modifié depuis: voir O.M.S., R.S.I. (1969) (3e éd., 1983).
154 R S.I. (1969), art. 88 §§1 et 5.
155 On peut cependant parler sans abuser des mots d’un pouvoir “quasi réglementaire”: Bélanger, M., “Réflexions sur la réalité du droit international de la santé,” (1985) 2 R.Q.D.I. 19, à la p. 31.Google Scholar
156 Supra, note 148.
157 L’O.A.C.I. compte actuellement 157 États membres.
158 Convention de Chicago, supra, note 148, art. 90a.
159 Id., art. 38. Ce terme n’est pas sans rappeler la technique par laquelle, en droit constitutionnel canadien, le Parlement fédéral et les Assemblées provinciales sont autorisés à déroger, par une disposition législative expresse, à certains droits et libertés garantis par la Constitution. L’idée semble en effet être la même dans les deux cas: sauvegarder la souveraineté des États au sein de l’Organisation internationale et protéger la “souveraineté parlementaire” à l’encontre de règles constitutionnelles qui pourraient s’avérer trop contraignantes dans des circonstances exceptionnelles. Voir Loi constitutionnelle de 1982, adoptée en tant qu’annexe? de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982 (R.-U.), p. 11, art. 33. Voir Hogg, P.W., Constitutional Law of Canada (2e éd., 1985), pp. 259, 690 et ssGoogle Scholar. Ce pouvoir dérogatoire existe également dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, L.R.Q., c. C-12, art. 52. Voir Morin, J.-Y., “La constitutionnalisation progressive de la Charte des droits et libertés de la personne,” (1987) 21 R.J.T. 25, à la p. 54.Google Scholar
160 Convention de Chicago, supra, note 148, art. 38.
161 Voir Mateesco Matte, N., Traité de droit aérien-aéronautique (3e éd., 1980), P. 197·Google Scholar
162 Une minorité de 22 États membres peut de la sorte imposer les démarches de l’art. 38 aux 157 États membres de l’Organisation. La chose s’est produite ré-cemment au sujet du 27e amendement à l’Annexe 2, C-Min. 117/12 (10 mars 1986). Voir Milde, M., “Interception of Civil Aircraft vs. Misuse of Civil Aviation,” (1986) 11 Annales de droit aérien et spatial 105, n. 1.Google Scholar
163 Reuter et Combacau, op. cit. supra, note 60, pp. 280–81.
164 O.A.C.I., Doc. 5701, c/672, pp. 57–60, par 332; Règles de l’air — Annexe s à la Convention sur l’Aviation civile internationale (8e éd., juil. 1986), art. a.1.1, note. Sur l’origine de cette décision, voir Carroz, J., “International Legislation on Air Navigation over the High Seas” 26 J.A.L.C. 158, aux pp. 160, 170Google Scholar. La Convention sur le droit de la mer, supra, note 42, remet-elle en question ce pouvoir législatif du Conseil de l’O.A.C.I. à l’égard de l’espace aérien situé au-dessus de la zone économique exclusive de 200 milles marins réservée aux États (articles 55–75)? Les “droits souverains” de l’État côtier étant limités aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, le statut de l’espace aérien surjacent ne paraît pas devoir être modifié. En outre, l’article 86 réserve les libertés des États et renvoie à l’article 58 (liberté de survol). Voir Milde, M., “U.N. Convention on the Law of the Sea: Possible Implications for International Air Law,” (1983) 8 Annales de droit aérien et spatial 167, aux pp. 175, 193Google Scholar. Cette question n’est pas définitivement réglée, cependant.
165 Traité instituant la Communauté économique européenne, 25 mars 1957, (1958) 298 R.T.N.U. il (texte initial) [ci-après dénommé Traité de Rome], reproduit dans Morin, Rigaldies et Turp, p. 373. On trouve également un compendium pratique des documents communautaires dans Philip, C., Textes institutifs des Communautés européennes (1984)Google Scholar.
166 Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, J.O.C.E., 13 juil. 1967, n° 152, p. 1, reproduit dans Morin, Rigaldies et Turp, p. 422.
167 Traité de Rome, supra, note 165, art. 10, 13, 14 §2, 20,43,49, 51.
168 Id., art. 14, 20, 33 §8,43 §2, 51, etc.
169 Acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, J.O.G.E., 15 nov. 1985, L 302, p. 9, art. 14, reproduit dans Morin, Rigaldies et Turp, p. 431.
170 Id., art. 15, modifiant le Traité, supra, note 165, art. 10.
171 Traité de Rome, supra, note 165, art. 169, 170–86.
172 Id., art. 173. Elle peut également former un recours sur les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement. Le renvoi à titre préjudiciel par les juridictions des États membres est prévu à l’art. 177.
173 Id., art. 187 et 192.
174 CJGE 15 juil. 1964, 6/64 Recueil 1964, p. 1141, à la p. 1158. Voir également CJCE 5 fév. 1963 (van Gend en Loos), 26/62 Recueil 1963, p. 7, à la p. 23; id., 9 mars 1978 (Simmenthal), 106/77 Recueil 1978, p. 629, à la p. 643. Certains auteurs en ont tiré la conclusion que le droit communautaire constitue un nouveau “système constitutionnel” : voir Mitchell, J.D.B., “The Sovereignty of Parliament and Community Law: The Stumbling-Block that Isn’t There,” (1979) 55 International Affairs (R.I.I.A.) 33, à la p. 40 CrossRefGoogle Scholar, mais voir Taylor, P., The Limits of European Integration (1983), pp. 277 et ssGoogle Scholar.
175 CJCE 6 oct. 1970 (Franz Grad c. Finanzamt Traunstein), 9/70 Recueil 1970, p. 825, à la p. 838. La Cour a dégagé une présomption d’effet direct même dans le cas des directives.
176 V.g., Reuter et Combacau, op. cit. supra, note 60, p. 386; Colliard, op. cit. supra, note 61, p. 541.
177 Traité de Rome, supra, note 165, art. 137–44 (Assemblée européenne), modifié par l’Acte portant élection des membres de l’Assemblée au suffrage universel direct, 20 sept. 1976, Traités et documents relatifs à la CEE (Doc. franç. n° 4323, 19 oct. 1976), reproduit dans Morin, Rigaldies et Turp, p. 426 [ci-après dénommé Acte de Bruxelles]; Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 4 nov. 1950, S.T.E. n° 5, art. 19–59, reproduite dans Morin, Rigaldies et Turp, p. 343 et ss., où l’on trouvera également les protocoles additionnels.
178 Op. cit. supra, note 61, pp. 286, 292.
179 Id., pp. 295–96.
180 Voir Héraud, G., Les principes du fédéralisme et la Fédération européenne (1968), pp. 43–60 Google Scholar; Wheare, K.C., Federal Government (4e éd., 1963), pp. 10 et ssGoogle Scholar.
181 Décision du ai avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés, J.O.C.E., 28 avril 1970, L 94, p. 19, art. 2–5. Voir Godet, M. et Ruyssen, O., L’Europe en mutation (Commission des C.Ê., 1980), p. 99.Google Scholar
182 Traité de Rome, supra, note 165, art. 164–88.
183 Id., art. 228, 229, 231. Voir Sauvignon, E., “Les Communautés européennes et le droit de légation actif,” (1978) R.M.C. 176 Google Scholar; Leopold, P.M., “External Relations Power of E.E.C, in Theory and Practice,” (1977) 26 I.C.L.Q. 54–80.CrossRefGoogle Scholar
184 Voir Colliard, op. cit. supra, note 61, p. 528; Reuter et Combacau, op. cit. supra, note 61, pp. 360, 376.
185 Traité de Rome, supra, note 165, art. 236. Sur l’ensemble de la question, voir Taylor, op. cit. supra, note 174, pp. 275 et ss.
186 Id., art. 240. Par contraste, le Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier, du 18 avril 1951, n’a été conclu que pour une période de 50 ans.
187 Convention de Vienne sur le droit des traités, supra, note 11 art. 56§1, reproduite dans Morin, Rigaldies et Turp, pp. 217, 233.
188 P. Taylor est enclin à penser que l’absence de toute clause de retrait du Traité de Rome ne saurait exclure cette possibilité. L’absence d’allusion à cette ques-tion en 1957 tient, selon lui, au fait qu’on ne parle pas de divorce au moment d’un mariage (op. cit. supra, note 174, p. 277). Voir aussi Soldâtes, P., “Durée et dénonciation des traités de Rome,” (1969) 47 R.D.I.S.D.P. 1.Google Scholar
189 C’est l’expression qu’emploie Friedman (op. cit. supra, note 130, p. 99). Voir également Dagtoglu, P.D., “How Indissoluble Is the Community?” dans Dagtoglu, P.D. (dir.), Basic Problems of the European Community (1975), p. 264 Google Scholar. Le point de vue fédéraliste européen est exprimé par Kinsky, F. et Talichet, L., L’Europe et l’indépendance nationale (1979), p. 18.Google Scholar
190 Arrangements intervenus à Luxembourg entre les six États membres de la C.Ê.E., 29 janv. 1966, Traités et documents, supra, note 177, p. 81, par. I et II, reproduits dans Morin, Rigaldies et Turp, p. 429.
191 Acte de Bruxelles, supra, note 177, art. 1er.
192 Supra, note 165, art. 137–44.
193 Id., art. 144.
194 Décision 71 DC des 29–30 déc. 1976, Rec. 15 (Assemblée européenne), reproduite dans Favoreu, L. et Philip, L., Les grandes décisions du Conseil constitutionnel (4e éd., 1986) p. 332.Google Scholar
195 Id., pp. 334–35.
196 Id., p. 349 (observations de L. Favoreu et L. Philip). Le cas de l’Irlande est également fort instructif. Le 9 avril 1987, la Cour suprême a déclaré “anti-constitutionnel” l’Acte unique européen, infra, note 197, après que le Parlement l’eût approuvé, au motif que cet accord international portait atteinte à la neutralité de l’Irlande, consacrée par la Constitution de 1937, en institu-tionallisant la coopération politique entre les Douze. Voir C.E. Informations, n° 191 (15 avril 1987), p. 1. La difficulté a pu être surmontée par la tenue d’un référendum qui a permis de modifier la Constitution : Le Monde, 11 et 14 avril 1987.
197 Bulletin des Communautés européennes, Supplément 2/86, reproduit dans (1986) 5 D.J.I. 385 et dans Morin, Rigaldies et Turp, p. 442.
198 Id., art. 6 et 7, modifiant art. 7, 49, 54, 56, 57 et 149 du Traité de Rome, supra, note 165. Si le Parlement rejette la position du Conseil, celui-ci ne peut statuer “en deuxième lecture” qu’à l’unanimité.
199 Id., art. 8 et 9, modifiant les art. 337 et 338 du Traité de Rome, supra, note 165.
200 Voir Commission des Communautés Européennes, L’achèvement du marché intérieur: Livre blanc de la Commission à l’intention du Conseil européen (juin 1985).
201 Voir Colliardj op. cit. supra, note 60, p. 687; Sabourin, L., “La contribution du Québec aux organisations internationales,” (1984) 1 R.Q.D.I. 319, à la p. 320.Google Scholar
202 Charte des droits, supra, note 51, préambule.
203 Id., art. 1er.
204 Sommaire des co-présidents de la Conférence internationale sur la coopération et le développement, Cancun, 33 oct. 1981, reproduit dans Stern, p. 388. La Conférence n’a pas émis de communiqué formel.
205 Voir Flory, M., “Souveraineté des États et coopération pour le développement” (1974) 141 R.C.A.D.I. 253, aux pp. 261, 313 et ss.Google Scholar
206 Charte des Nations Unies, supra, note 1, préambule.
207 Pour le pourcentage que représente l’aide publique au développement par rapport au P.N.B, de chaque pays, voir O.C.D.E., op. cit. supra, note 103, p. 57 (chiffres de 1984–85). La VIe C.N.U.C.E.D., supra, note 99, vol. I, p. 136, constatait que l’aide publique au développement stagnait, “s’établissant à moins de la moitié de l’objectif de 0,7% [du P.N.B.] fixé il y a plus de dix ans,” et la VIIe C.N.U.C.E.D. a demandé aux pays développés “de redoubler d’efforts pour atteindre, dès que possible, l’objectif de 0,7 p. 100 du produit national brut pour l’A.P.D. totale”: voir C.N.U.C.E.D., Bulletin, n° 235 (août-sept. 1987), p. 5.
208 Voir la Déclaration de solidarité des pays ayant en commun l’usage du français, 4 sept. 1987, dans Deuxième Conférence des chefs d’État et de Gouverne-ment des pays ayant en commun l’usage du français, Québec, 2–4 sept. 1987, Rapport général (provisoire), p. A-139 (multigr.). Voir également Léger, J.-M., La Francophonie: grand dessein, grande ambiguïté (1987)Google Scholar, qui insiste sur la “consternante inadéquation entre l’immense effort de réflexion et de proposition consenti depuis un quart de siècle et la minceur des résultats enregistrés” (p. 190) ; Tétu, M., Francophonie: Histoire, problématique, perspectives (1987), p. 286 Google Scholar; Maugey, A., La Francophonie en direct (Conseil de la langue française, 1987), t. 2 (L’espace économique)Google Scholar; Morin, J.-Y., “Le premier Sommet de la Communauté francophone,” (1986) 3 R.Q.D.I. 79.Google Scholar
209 Id., p. A-85.
210 Convention sur le droit de la mer, supra, note 42, art. 136.
211 Id., art. 150.
212 Id., art. 156–60.
213 Voir Levy, J.-P., “La Commission préparatoire de l’Autorité internationale des Fonds marins et du Tribunal international du droit de la mer,” (1986) 1 Espaces et ressources marines 137, aux pp. 139–78.Google Scholar
214 Id., p. 153; voir Doc. N.U. LOS/PCN/SNC/WP 1, 8 mars 1984: la seule table des matières du projet occupe 18 pages.
215 Id., p. 178.
216 Supra, note 197, art. 13–30.
217 Cette perspective est redoutée, non sans raison, par la doctrine fédéraliste, laquelle ne voit guère l’intérêt de remplacer les États-nations existants par un super-État qui présenterait les mêmes caractéristiques. Le “fédéralisme intégral,” en particulier, s’est préoccupé de construire une “théorie pure du fédé-ralisme” qui ne soit pas seulement politique, mais propose une méthodologie générale de l’organisation des sociétés. Le Mouvement fédéraliste européen, qui préconise la création d’une “fédération européenne, élément constitutif d’une fédération mondiale,” a pris position contre un État européen qui prétendrait absorber toutes les fonctions des États membres et mettre en place des institutions centralisatrices. La Charte fédéraliste (1964), adoptée par le M.F.E., étend le fédéralisme à l’ensemble des structures économiques et sociales. Le Mouvement se soucie également des droits des collectivités ethniques ou linguistiques dans l’Europe fédérale. Voir G. Héraud, op cit. supra, note 180, pp. 74, 95 et passim. Le fédéralisme intégral a pris position en faveur d’une fédération qui assure certaines fonctions administratives et techniques nécessaires à la cohésion de l’ensemble, mais reconnaît l’autonomie des collectivités composantes en leur laissant le plus grand nombre de compétences possible, selon le principe d’exacte adéquation. Voir Aron, R. et Marc, A., Principes du fédéralisme (1948), pp. 99 et ss.Google Scholar; Nigoul, C., À la découverte du fédéralbme (1979), pp. 10 et ss.Google Scholar; Kinsky et Talichet, op. cit. supra, note 189, p. 21; Voyenne, B., Histoire de l’idée fédéraliste (1981), t. III, pp. 235 et ss.Google Scholar
218 Carré de Malberg, R., Contribution à la théorie générale de l’État, spécialement d’après les données fournies par le droit constitutionnel français (1920–22) t. Ier, p. 79 Google Scholar. L’auteur distinguait en outre une troisième signification: la position qu’occupe dans l’État le titulaire suprême de la puissance étatique. Voir Bacot, G., Carré de Malberg et l’origine de la dutinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale (1985), pp. 9 et ss.Google Scholar
219 Cette distinction est reprise par J. Touscoz, loc. cit. supra, note 6, pp. 214–15; elle paraît analogue à celle établie par le Pr Dupuy entre la “limitation” de la souveraineté et son “aliénation,” dans la Sentence Texaco supra, note 71, par. 77.
220 Thierry, H., Combacau, J., Sur, S. et Vallée, C., Droit international public (4e éd., 1984), p. 647.Google Scholar
221 Plantey, A., Prospective de l’État (1975), p. 188.Google Scholar
222 Taylor, op. cit. supra, note 174, pp. 394, 898 et ss; Hay, P., Federalism and Supranational Organizations (1966), pp. 55 et ss.Google Scholar
223 Harvey, J. et Bather, L., The British Constitution (1965), p. 541.Google Scholar
224 Stern, op. cit. supra, note 41, p. xxxix et ss.
225 Fontaine, A., Le dernier quart du siècle (1976), p. 4.Google Scholar
226 de Visscher, C., Théories et réalités en droit international public (4e éd., 1970), P. 125.Google Scholar
227 Op. cit. supra, note 60, p. 381. On trouvera amplement matière à réflexion sur la question des valeurs dans L’avenir du droit international dans un monde multiculturel (Colloque de l’Académie de droit international de la Haye et de l’Université des Nations Unies, 1984).
228 De Visscher, op. cit. supra, note 226, p. 217.
229 de Bottini, R., “Souveraineté et conflit de loi,” dans Bettati, , de Bottini, , Isoart, , Rideau, , Sortais, , Touscoz, et Zarb, , op. cit. supra, note 6, pp. 141, 164.Google Scholar
230 Polin, R., “Peut-il exister un ordre politique mondial?,” (1986) Revue des Sciences morales et politiques 611.Google Scholar
231 Kant, E., Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique (1784), pp. 24–26 Google Scholar. Voir Ferrari, J., Kant ou l’invention de l’homme (1971), p. 164.Google Scholar
232 Projet de paix perpétuelle (1795; trad. J. Gibelin, 2e éd., 1970), pp. 22, 26–28; The Philosophy of Law: An Exposition of the Fundamental Principles of Jurisprudence as the Science of Right (1796; trad. Hastie, 1887), p. 224.
233 Virally, M., “Une pierre d’angle qui resiste au temps: avatars et pérennité de l’idée de souveraineté,” dans Les relations internationales dans un monde en mutation (Genève, I.U.H.E.I., 1977), pp. 179, 186, 193.Google Scholar
234 L’État souverain et l’organisation internationale (1959), p. 33.
235 Déclaration sur te droit au développement, 4 déc. 1986, A.G. Rés. 41/128, annexe, Doc. N.U. A/Rés/41/128 (1986). Cette résolution a été préparée par un long débat au sein des organes et institutions spécialisées de l’ONU, v.g., Commission des droits de l’homme, Rés. 4 (XXXV), du 2 mars 1979, Rapport sur la 35e session [de la Commission], Doc. N.U. E/1979/36, p. 115, qui souligne le devoir de tous les États de créer “les conditions nécessaires à la jouissance du droit au développement.” L’Assemblée générale elle-même y avait fait allusion à quelques reprises: Autres méthodes et moyens qui s’offrent dans le cadre des organismes des Nations Unies pour mieux assurer la jouis-sance effective des droits de l’homme et des libertés fondamentales, A.G. Rés. 34/46, Doc. off. A.G., 34e session, supp. n° 46, p. 191, Doc. N.U. A/34/46 (1979), soulignant que le droit au développement est un droit de l’homme (par. 8). Auparavant, les devoirs des pays développés avaient fait l’objet de la réflexion des Églises: dès 1967, notamment, l’encyclique Populorum progressió du Pape Paul VI avait fait du développement “le nouveau nom de la paix” (Acta Apostolicae Sedis, t. 59, pp. 257–99, par. 87). Tout récemment, l’encyclique Sollicitudo rei socialis du Pape Jean-Paul II, du 30 déc. 1987 (Typogr. polyglotte vatic, version franç., 1988), souligne “le lien intrinsèque entre le développement authentique et le respect des droits de l’homme” et fait de la “collaboration au développement” un devoir qui s’impose particulièrement aux pays développés et la clé de la question sociale dans sa dimension mondiale (par. 9, 30, 32, 47).
236 Voir Sanson, H., “Le droit au développement comme norme métajuridique en droit du développement,” dans La formation des normes en droit international du développement (1982), pp. 60, 62Google Scholar; Pellet, A., “Note sur quelques aspects juridiques de la notion de droit au développement,” dans id., pp. 71 et ss.Google Scholar
237 Voir Alston, P., “The Right to Development at the International Level,” dans Snyder et Sathirathay op. cit. supra, note 6, pp. 811, 819Google Scholar. La question a été discutée à la Commission des droits de l’homme, où la majorité des États ont tenu à affirmer que ce droit appartenait aussi bien aux “nations” qu’aux individus: Rés. 5 (XXXV), 2 mars 1979, dans Rapport, supra, note 235, p. 117. Voir également le Rapport du Secrétaire général du l’ONU sur les dimensions internationales du droit au développement, Doc. N.U. E/CN.4/ 1334(1979), par. 39–54.
238 11 déc. 1969, A.G. Rés. 2542, Doc. off. A.G., 24e session, supp. n° 30, p. 51, Doc. N.U. A/7630 (1970), art. 1er. Voir Virally, M., L’organisation mondiale (1972), p. 317.Google Scholar
239 Supra, note 235, art. 2 §1 et 3 §1.
240 Compte tenu de la mise en garde non moins légitime de la Commission des droits de l’homme, dans son Rapport, supra, note 235, p. 31, par 135, selon laquelle “toute tentative d’élaborer des critères généraux [en matière de droits de l’homme] doit être faite avec précaution car ces critères [peuvent] être utilisés pour se soustraire à la responsabilité de l’instauration d’un nouvel ordre économique international.”