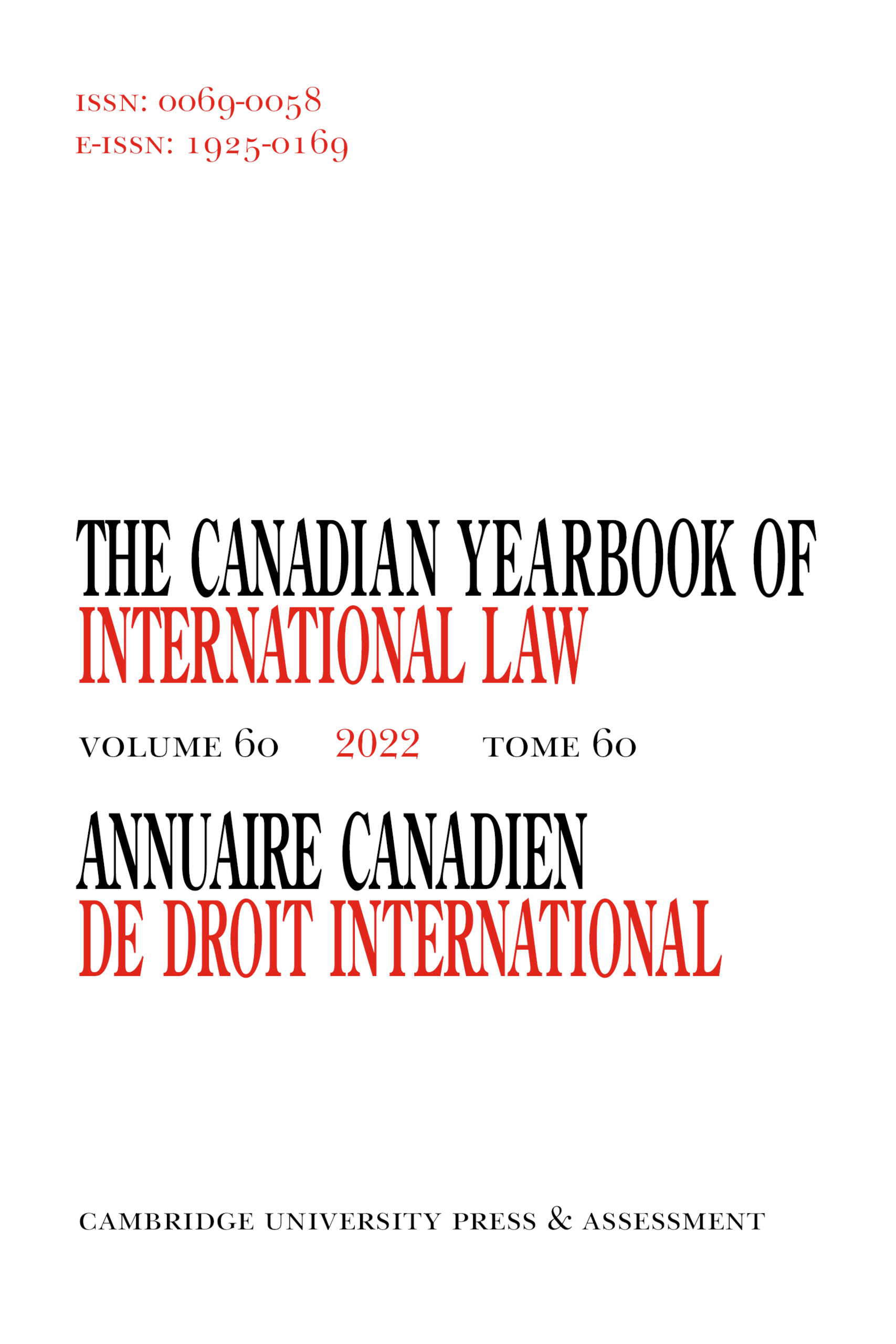No CrossRef data available.
Article contents
Abstract
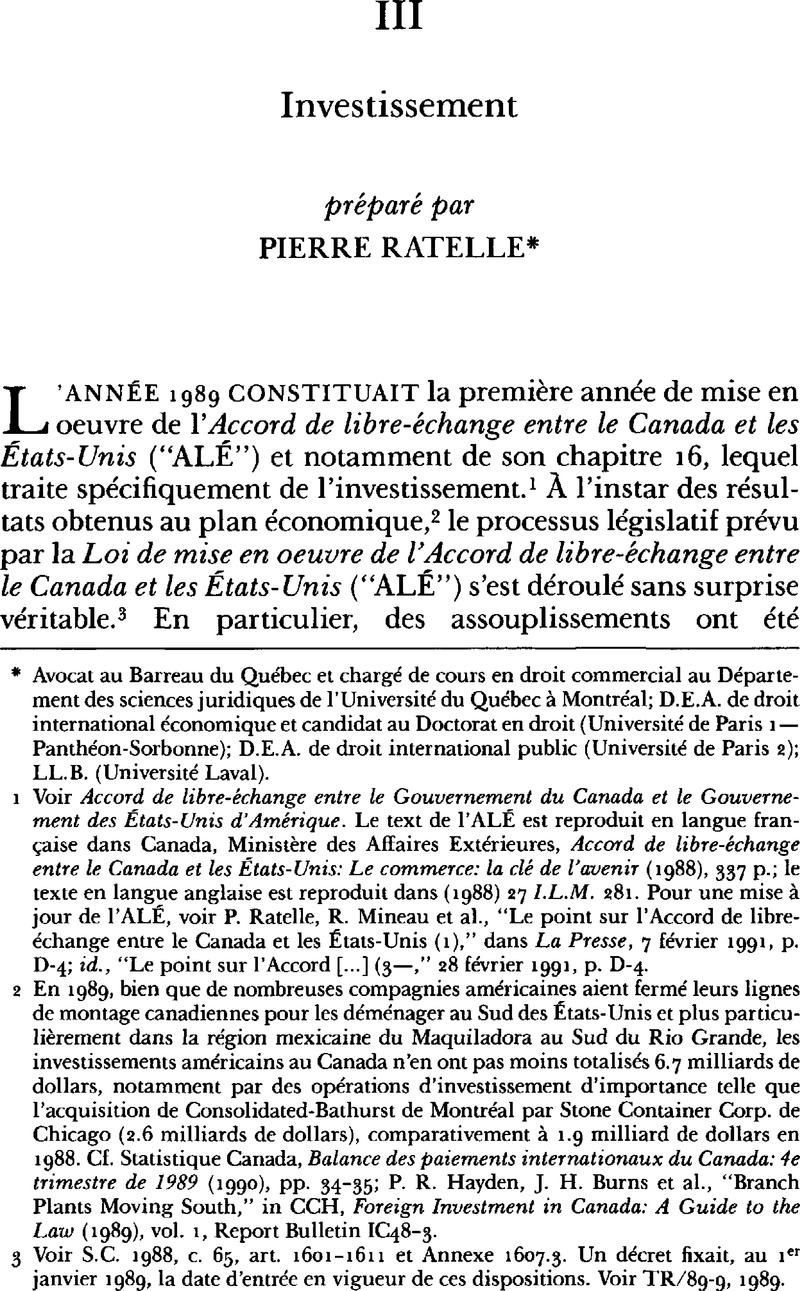
- Type
- Chronique de droit international économique en 1989 / Digest of International Economic Law in 1989
- Information
- Canadian Yearbook of International Law/Annuaire canadien de droit international , Volume 28 , 1991 , pp. 449 - 458
- Copyright
- Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1991
References
1 Voir Accord de libre-échange entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique. Le text de l’ALÉ est reproduit en langue française dans Canada, Ministère des Affaires Extérieures, Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis: Le commerce: la clé de l’avenir (1988), 337 p.; le texte en langue anglaise est reproduit dans (1988) 27 I.L.M. 281. Pour une mise à jour de l’ALÉ, voir Ratelle, P., Mineau, R. et al., “Le point sur l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis (1),” dans La Presse, 7 février 1991, p. D-4Google Scholar; id., “Le point sur l’Accord […] (3—,” 28 février 1991, p. D–4.
2 En 1989, bien que de nombreuses compagnies americaines aient ferme’ leurs lignes de montage canadiennes pour les ddmdnager au Sud des f tats-Unis et plus particu- IiPrement dans la kgion mexicaine du Maquiladora au Sud du Rio Grande, les investissements americains au Canada n’en ont pas moins totalisds 6.7 milliards de dollars, notamment par des opdrations d’investissement d’importance telle que l’acquisition de Consolidated-Bathurst de Montreal par Stone Container Corp. de Chicago (2.6 milliards de dollars), comparativement A 1.9 milliard de dollars en 1988. Cf. Statistique Canada, Balance des paiements internationaux du Canada: 4e trimestre de 1989 (1990), pp. 34–35; Hayden, P.R., Burns, J.H. et al., “Branch Plants Moving South,” in CCH, Foreign Investment in Canada: A Guide to the Law (1989), vol. 1,Google Scholar Report Bulletin IC48–3.
3 Voir S.C. 1988, c. 65, art. 1601–1611 et Annexe 1607.3. Un décret fixait, au 1er janvier 1989, la date d’entrée en vigueur de ces dispositions. Voir TR/89–9, 1989.
4 Aux termes de la Loi sur Investissement Canada, tout investissement étranger est sujet à un examen par l’agence Investissement Canada (“Investissement Canada”) s’il consiste soit en l’acquisition directe d’une entreprise canadienne dont les actifs atteignent au moins cinq millions de dollars, soit en l’acquisition indirecte (acquisition qui, à la suite d’une transaction effectuée à l’étranger, entraîne un changement touchant le contrôle d’une filiale au Canada) d’actifs canadiens qui atteignent au moins 50 millions de dollars et qui constituent plus de 50% de la valeur de l’ensemble de la transaction internationale. Les acquisitions d’un montant inférieur aux seuils précédents ainsi que les investissements visant à créer de nouvelles entreprises dans des secteurs délicats du point de vue culturel peuvent être soumis à un examen. Voir S.C. 1985, c. 20, art. 14 et 15; TR/85–128.
5 Voir Modification au Règlement d’Investissement Canada, DORS/89-6g, (1989) 123 Gaz. Can. II 85g. Des modifications au Règlement étaient rendues nécessaires afin de s’assurer que les investisseurs non-Canadiens ont bien compris les modifications apportées à la LIC en conséquence de l’ALÉ et s’y sont conformés.
6 II s’agit de la Loi sur les banques, L.R.C. 1985, c. B-1, la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, L.R.C. 1985, c. I-14, la Loi sur les compagnies de prêt, L.R.C. 1985, c. L-12, la Loi sur les sociétés d’investissement, L.R.C. 1985, c. I-22, et la Loi sur les sociétés de fiducie, L.R.C. 1985, c. T-16.
7 Voir S.C. 1985, c. 20, art. 14; modifié par l’ALÉ, art. 135.
8 Voir LALE, Annexe 1607.3, art. 2 § (a)(i)(A).
9 Voir supra, note 4.
10 Voir LALÉ, Annexe 1607–3, art. 2 § (a)(ii)(A).
11 Voir supra note 4.
12 Les entreprises exclues sont les suivantes: les entreprises pétrolières, gazières et uranifères, les entreprises offrant des services financiers (sauf les services d’assurance), les entreprises fournissant des services de transport et les entreprises culturelles. Voir LALÉ, art. 1601 ss. 2 et 2005.
13 Voir LALÉ, art. 47–48, 134, 138 et 140.
14 Voir Loi sur les banques, supra, note 6, art. 302 § 8; modifiée par LALÉ, art. 49.
15 La clause “Exon-Florio” de l’Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 (U.S. Congressional and Administrative News, vol. 4, 1988, p. 1547; P.L. 100–48, p. 102; Stat. 1107) autorise le Président américain à examiner l’incidence sur la sécurité nationale des prises de contrôle d’entreprises américaines par des sociétés étrangères. Le Bryant Bill (HR 5) force l’investisseur étranger qui acquiert 5% ou plus d’une compagnie, d’une propriété ou d’un actif valant plus de 5 millions de dollars d’en faire l’enregistrement. Lorsque le pourcentage est de 25% et la valeur de 20 millions de dollars, l’investisseur étranger doit fournir des informations détaillées au sujet de son organisation. Le Marquey Bill (HR 5267) concerne la propriété étrangère dans le secteur des câblodistributeurs; il aurait pour effet de restreindre la propriété étrangère à 20% de tout le secteur. Le Benson Bill (S 137), du nom de l’ancien candidat de la dernière plate-forme électorale démocrate à la vice-présidence des États-Unis, vise à instaurer un système de restriction des dépenses en provenance des individus et des entreprises qui contribuent aux dépenses électorales des candidats qui se présentent comme sénateurs. Une disposition interdirait à des entreprises américaines contrôlées par des étrangers de pouvoir contribuer aux financements des Political Action Committees.
16 Voir notamment la Lettre du 8 décembre 1989 adressée à Monsieur Rodney Brock, Directeur de l’Investissement international au Département américain du Commerce, par Monsieur Joe Norton, Responsable de l’Investissement international à l’Ambassade du Canada à Washington, 6 p. (non-publiée).
17 Voir supra note 4.
18 La compagnie Connaught oeuvre dans le domaine des soins de santé et est le premier fabricant canadien de vaccins. Une de ses deux filiales d’exploitation, Connaught Laboratories Ltd., a une signification historique bien particulière pour plusieurs Canadiens puisque c’est dans ce laboratoire qu’un chercheur de l’Université de Toronto, Frederick Banting, et son assistant, Charles Best, ont dans les années 20 isolé l’insuline; ce qui leur a valu le seul prix Nobel du Canada en médecine.
19 Mérieux est aussi un important fabricant de vaccins; il effectue des activités de R.-D. dans le domaine de la production et de la commercialisation des vaccins, des protéines sanguines et d’autres produits biologiques destinés aux humains. Il est également actif, par l’intermédiaires de quelques filiale, dans les domaines de la médecine vétérinaire et la génétique avicole. Mérieux est contrôlé par Rhône-Poulenc, une société multinationale française de produits pharmaceutiques, elle-même contrôlée par le gouvernement français.
20 Voir supra note 4.
21 Voir LIC, art. 21.
22 Voir Hayden, P.R., Goodeve, S.A. et al., “Investment Canada Intervenes in Connaught Takeover,” in CCH, Foreign Investment in Canada: A Guide to the Law (1989), vol. 1,Google Scholar Report Bulletin IC52-1.
23 Voir LIC, art. 22 § 1 et 23 § 2.
24 Les engagements de Mérieux comprennent notamment la construction d’un centre de biotechnologie (coût estimé entre 30 et 40 millions de dollars) et de la R.-D. (80 millions et plus annuellement). Voir Investissement Canada, Rapport annuel 1989–1990 (1990), p. 40.
25 Voir Communiqué de Presse d’Investissement Canada, 13 décembre 1989, 6 p.
26 Au cours de l’année de référence, le Canada a également signé ou vu entrer en vigueur des accords bilatéraux sur l’impôt conclus avec le Luxembourg, la Papouasie-Nouvelle Guinée, la Pologne et la Zambie. Voir Convention entre le Canada et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune, Luxembourg, signée le 17 janvier 1989; Accord entre le Canada et la Papouasie-Nouvelle-Guinée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu, signé à Vancouver, le 16 octobre 1987, en vigueur le 21 décembre 1989; Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République Populaire de la Pologne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Varsovie, le 4 mai 1987, en vigueur le 30 novembre 1989; Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Zambie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu, signée à Lusaka, le 16 février 1984, en vigueur le 28 décembre 1989. Ces accords s’ajoutent à une longue chaîne d’accords déjà conclus par le Canada en semblable matière. Voir Ministère des Affaires Extérieures, Traités en vigueur; liste des traités bilatéraux et multilatéraux du Canada en vigueur au 1er janvier 1988 (1988), 111p.
27 Voir Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques sur l’encouragement et la protection réciproque des investissements, Moscou, signé le 20 novembre 1989. Il entrera en vigueur à la date à laquelle les deux pays auront notifié par écrit l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet. Voir Accord, art. XIV § 1.
28 La définition de l’investissement se décompose en deux parties: la première réfère aux “avoirs de toute nature"; tandis que la seconde spécifie par une liste non-limitative ce que peuvent être ces “avoirs de toute nature. “ Voir Accord, art. I § (b).
29 La définition de l’investisseur couvre à la fois les personnes physiques et les personnes morales. Les personnes physiques sont non seulement des “citoyens” mais aussi des “résidents permanents.” Les personnes morales peuvent être “toute société par actions, société, société de fiducie, joint venture, organisation, association ou entreprise.” Elles doivent cependant être enregistrées ou dûment constituées conformément aux lois applicables de leur pays d’origine, c’est-à-dire le Canada ou l’URSS selon le cas. Elles doivent également avoir, conformément à la législation de leur pays d’origine, “qualité juridique pour effectuer des investissements” sur le territoire de l’autre pays. Voir Accord, art. I s. (d).
30 Le droit du Canada et de l’URSS d’assujettir les investissements à des procédures de déclaration ou d’autorisation préalable, lorsque ceux-ci sont admis sur leur territoire, est préservé implicitement par l’Accord. Voir Accord, art. II s. 2.
31 Aux termes de l’Accord, les investissements du Canada ou de l’URSS bénéficieront “en tout temps d’un traitement juste et équitable” sur le territoire de l’autre. Sauf concernant, quelques exceptions, le traitement de l’investisseur ressortissant de la Nation la plus favorisée (“traitement NPF”) est également prévu. Voir Accord, art. III et IV.
32 Le droit souverain que possèdent le Canada et l’URSS de prendre des mesures d’“expropriation,” de “nationalisation” ou d’“effets équivalents” contre les investissements de l’autre est reconnu, mais son exercice est encadré dans un ensemble de conditions formelles et matérielles qui peut engager la responsabilité de l’un ou l’autre pays. Voir Accord, art. V-VI.
33 L’Accord prévoit que si le Canada ou l’URSS ou un de leurs organismes respectifs fait un paiement à un investisseur en vertu d’une garantie ou d’une assurance contractée à l’égard de son investissement, l’un reconnaît la subrogation en faveur de l’autre ou de l’organisme de celui-ci de tout droit ou titre détenu par l’investisseur, et vice versa. Voir Accord, art. VIII.
34 Le Canada et l’URSS garantissent à tout investisseur de l’autre un transfert de fonds dans un délai qui ne peut excéder deux ans, sauf en cas de difficultés exceptionnelles de la balance des paiements où il pourra alors atteindre cinq ans. Le régime de transfert de l’Accord prévoit également le traitement NPF. Voir Accord, art. VII.
35 Outre le recours à l’amiable, un investisseur du Canada ou de l’URSS peut recourir à un tribunal d’arbitrage ad hoc lorsque l’un de ces pays agit à titre de pays d’accueil. Le Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa Résolution 31/98 du 15 décembre 1976, sert de référence pour déterminer selon quelle procédure et quel droit le tribunal trouvera une solution au différend. Quant aux différends entre le Canada et l’URSS, hormis le recours à la voie diplomatique, chacun des pays peut demander à un tribunal d’arbitrage ad hoc de les trancher. La décision du tribunal est obligatoire pour les deux pays. Voir Accord, art. IX et XI.
36 II s’agit de l’abréviation anglaise des Trade-Related Investment Measures. Les TRIM sont, en gros, des conditions imposées par les pouvoirs publics aux investisseurs étrangers et qui modifient artificiellement les flux des échanges. À titre d’exemple, ce peut être des prescriptions relatives à la teneur en produits nationaux. Au sujet des TRIM en général, voir Kleitz, A., “Les entraves à l’investissement et distortions commerciales,” dans l’Observateur de l’O.C.D.E., no 162, février-mars 1990, pp. 23–27.Google Scholar
37 Les pays moins avancés craignent que l’interdiction ou l’encadrement des TRIM compromettent gravement leur souveraineté nationale en matière de politiques d’investissement et nuisent aux objectifs de celles-ci. Les pays développés sont, au contraire, favorables à l’idée que les mouvements transfrontières de capitaux soient les plus fluides possible. Cf. Nouvelles de l’Uruguay Round, NUR 15, 31 mars 1988, pp. 5–6; Ministère des Affaires Extérieures du Canada. Bureau des Négociations Commerciales Multilatérales, Les négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay; rapport d’étape (1988), p. 23.
38 Le compte rendu de la réunion de Genève a été distribué sous la cote MNT.TNC/ 10 (MIN); voir aussi Nouvelles de l’Uruguay Round, NUR 27, 24 avril 1989, p. 24.
39 Voir Nouvelles de l’Uruguay Round, NUR 30, 3 août 1989, p. 6.
40 Ibid.
41 Ibid.
42 Id., NUR 31, 167 octobre 1989, p. 5.
43 Cf. notamment Ministère des Affaires Extérieures du Canada. Bureau des Négociations Commerciales Multilaterales, Les négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay; rapport d’étape (avril 1989), p. 10.
44 L’ITN est une Décision du Conseil de l’OCDE qui résulte de la Déclaration et des Décisions de 1976 sur l’Investissement international et les Entreprises multinationales. L’ITN exige de tous les pays Membres qu’ils accordent aux entreprises étrangères ou sous contrôle étranger, une fois celles-ci établies sur leur territoire, un régime qui ne soit pas moins favorable que celui dont bénéficient les entreprises nationales. A ce sujet, voir OCDE, Rapport intermédiaire sur la Déclaration et les Décisions de 1976 (1982), p. 20.
45 Voir OCDE, Activités de l’O.C.D.E. en 1989 (1990), p. 127
46 Voir OCDE, Comité sur l’Investissement International et les Entreprises Multinationales, Strengthening the National Treatment Instrument and Procedures (Note by the Secretariat), IME (89)3(2nd Revision), distribué le 14 novembre 1989, diffusion limitée, p. 1. Selon des informations obtenues du ministère des Affaires extérieures et de la Délégation permanente du Canada auprès de l’OCDE, le Canada devrait formuler une réserve de type “fédérale” à ΊΊΤΝ proposé par le CIME, c’est-à-dire qu’il s’engagera à appliquer les dispositions de 1ΊΤΝ dans toute la mesure du possible compatible avec le régime constitutionnel du Canada qui prévoit la compétence des provinces pour prendre des mesures à l’égard de certaines questions relevant de ΓΙΤΝ. En particulier, le Canada s’efforcera de son mieux d’assurer que les obligations résultant de ΓΙΤΝ soient appliquées par les provinces canadiennes et s’engageait à soumettre toute mesure prise par une province, qui affecterait ΓΙΤΝ, aux procédures de révision et d’examen prévues par ΓΙΤΝ. Enfin, le Canada devrait formuler une exception à ΓΙΤΝ qui lui permettra de prendre de nouvelles mesures dans le domaine culturel de manière à favoriser ses propres industries culturelles.
47 Ces Codes datent des années 60 et sont des Décisions du Conseil de l’OCDE. Par conséquent, il s’agit d’accords internationaux ayant force obligatoire. Ces Codes sont des instruments juridiques par lesquels les pays Membres de l’OCDE s’engagent à réaliser la libération sur une base multilatérale et dans des conditions non discriminatoires, et à préserver les résultats obtenus. L’objectif fondamental de ces Codes est que les résidents des différents pays Membres puissent traiter des affaires entre-eux aussi librement que les résidents d’un même pays Membre. Voir Code de la libération des mouvements de capitaux (1990), pp. 5 et ss.; Code de la libération des opérations invisibles courantes (1990), pp. 5 et ss.
48 Voir OCDE, Activités de l’OCDE en 1989 (1990), p. 32; voir aussi Ley, R., “Mouvements de capitaux: nouvelle libéralisation,” dans l’Observateur de l’O.C.D.E., no 159, août-septembre 1989, pp. 22–26.Google Scholar
49 Les accords antérieurs concernaient les assurances (1984), le tourisme (1985) et les oeuvres audiovisuelles (1988). Les résultats des études menées sur ces secteurs ont fait l’objet d’articles déjà publiés dans l’Observateur de l’OCDE: “Obstacles aux échanges internationaux de services: assurances … et tourisme,” no 126, janvier 1984; “Les obstacles aux échanges internationaux de services; bancaires,” no 128, mai 1984; “Tourisme international: enfin un secteur à part entière,” no 38, janvier 1986; “Libéralisation des échanges et des investissements dans les services; le rôle des Codes de l’OCDE,” no 139, mars 1986; “Libéralisation des échanges les services; les oeuvres audiovisuelles,” no 141, juillet 1986.
50 Le Canada a adhéré au deux Codes en apposant des réserves: l’une de type “fédérale,” les autres ayant pour effet d’exclure certains mouvements de capitaux et opérations du champ d’application de ces Codes, dont notamment les investissements directs, les opérations immobilières, le transport routier, l’admission de titres étrangers sur le marché national des capitaux (dans la mesure où les provinces ont le pouvoir de légiférer pour restreindre ces opérations). Voir Code de la libération des mouvements de capitaux, supra note 47, Annexe B; Code de la libération des opérations invisibles courantes, supra note 47, Annexe B. Bien que la position du Canada n’est pas été rendue publique concernant l’accord sectoriel de 1989, des informations obtenues du ministère des Affaires extérieures et de la Délégation permanente du Canada auprès de l’OCDE sont à l’effet que le Canada réitérera sa réserve initiale concernant l’établissement de succursales de banques étrangères sur son territoire.