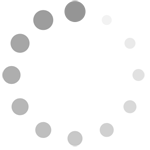Le XIIe sièkle, à la suite des fondations cisterciennes et à bur image, a vu I'essor d'une institution: celle des convers, fègres laϊques généralement issus de la paysannerie, vèritables moteurs de la mise en valeur, dans un système autarcique, de terres le plus souvent incultes - bois, friches, landes, marécages - concédées aux nouvelles colonies religieuses. Π y eut un ‘revers de médaille': ce fut, dans la seconde moitié du siécle, parfois avec récidives au début du XIIIe, l'esprit de rébellion entretenant l'agitation chez les fréres lais, suscitant violences et crimes, engendrant ici ou là des scissions au sein des monastères. Cisterciens, Prèmontrès, Grandmontains furent affrontès à de telles crises.’ Toutefois, une des plus précoces et sans doute la plus grave fut celle que connut I'Ordre gilhertin un quart de siècle après l'établissement du chef d'Ordre, le prieuré Sainte-Marie de Sempringham en 1139. A l'époque - dans les années 60 du XIIe siécle - il comptait douze maisons, dont neuf nunneries. ll fut ébranlé dans ses oeuvres vives car la crise faillit compromettre irrémédiablement le statut même de celles-ci, c'est-à-dire la réunion en un même lieu, mais stricternent séparées, de communautés masculines et féminines sous une même autorité et formant une unité économique et juridique, véritables monastères doubles (religieux et religieuses de choeur), ceci après I'institution d'une quatrième branche celle des chanoines.
Si j'ai résolu de présenter ici l'affaire des frères lais de Sempringham, c'est à Ia faveur d'un nouvel examen de la question d'après les documents aujourd'hui disponibles, en vue d'une nouvelle édition du Liber sancti Gileberti pour les OMT. Lorsque je publiai, partiellement, le Liber en 1943, mon propos concernait le procès de canonisation, étude de droit canonique autant que d'histoire religieuse. Je ne m'étais intéressée au dossier des fréres lais qu'à titre subsidiaire, le croyant inédit, mon information n'ayant pu être complétée en raison des événements. L'édition que Dom Knowles en avait donnée et la mienne supportaient des conclusions assez proches. Toutefois, elles diffèrent sur un point essentiel, à savoir la transmission des documents et, en conséquence. le manuscrit de base. Dom Knowles avait établi son édition sur le Codex Bodl. Digby 36, du XVe siècle. La mienne reposait sur le MS de la BL Cotton Cleopatra B I du ddbut du XIIIe siècle.