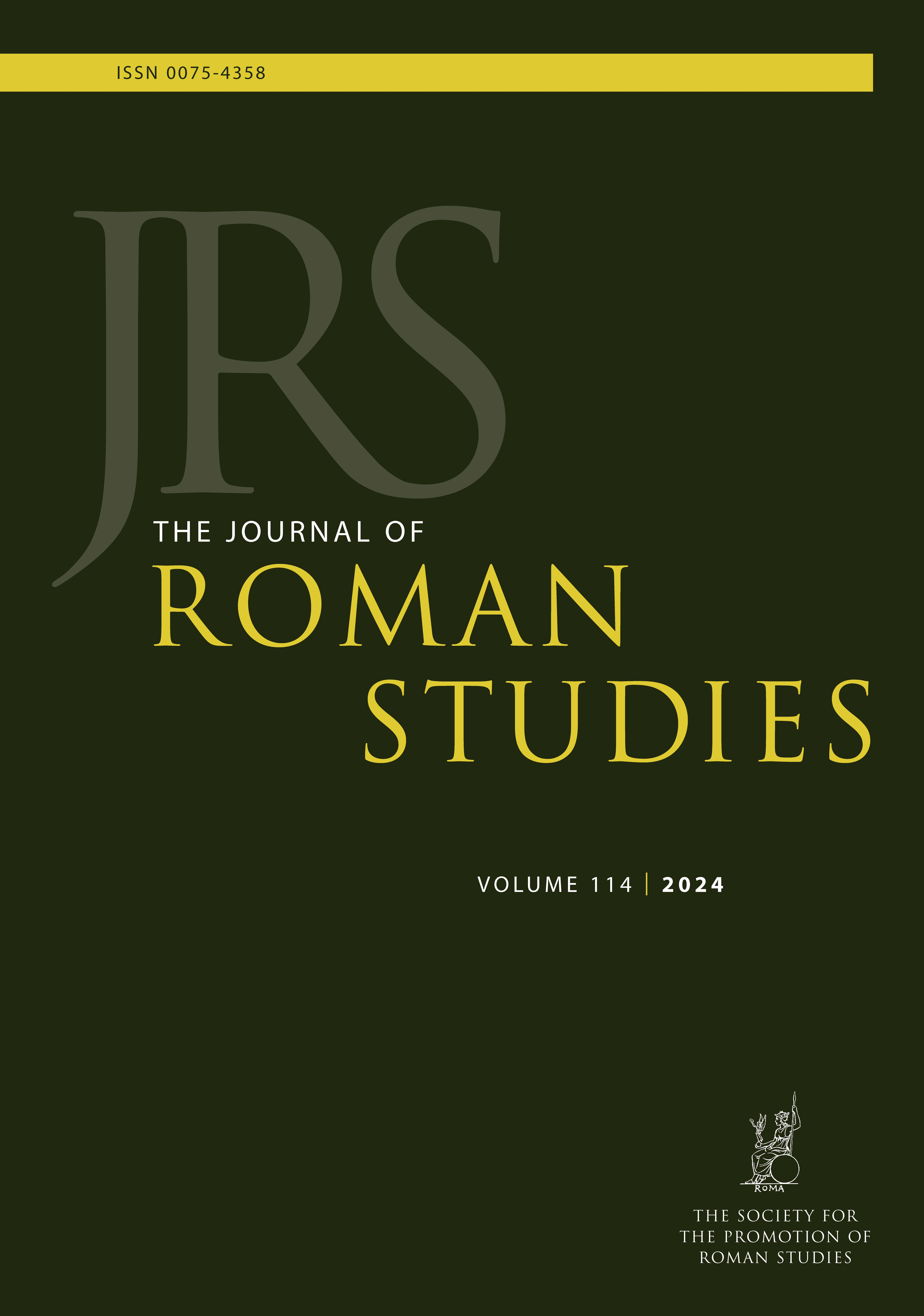Article contents
Les Otages Barbares au Debut de L'Empire*
Published online by Cambridge University Press: 24 September 2012
Extract
Exiger des otages ou en donner, afin de garantir des engagements reçus ou pris, est un fait courant pendant toute l'Antiquité — pour ne pas parler des temps qui l'ont suivie. Rome a fréquemment appliqué cet usage. Plus qu'aucun autre Etat antique? Les données brutes de la statistique conduiraient à l'affirmer. Mais elles demeurent sans portée, puisqu'elles ne peuvent pas se pondérer en fonction de la durée de chaque Etat, de l'activité de sa politique extérieure, de l'abondance et de la précision des détails fournis par nos sources sur cette politique. De toute façon, le recours aux otages n'était fait pour surprendre aucun de ceux que les hasards de la diplomatie ou de la guerre plaçaient au contact des Romains. Bien avant de connaître ceux-ci, tous connaissaient déjà le procédé, au moins pour l'avoir vu utiliser autour d'eux et, la plupart, pour l'avoir eux-mêmes utilisé à l'occasion. Il n'en a guère été de plus normal ni de mieux admis dans la pratique des rapports internationaux.
- Type
- Research Article
- Information
- Copyright
- Copyright © André Aymard 1961. Exclusive Licence to Publish: The Society for the Promotion of Roman Studies
Footnotes
Ce mémoire constitue le développement d'une partie de la communication, intitulée Les armées romaines et les lois de la guerre sous le Haut-Empire, que j'ai présentée au IIIe Congrès international des études classiques, à Londres, le 4 septembre 1959. J'en avais déjà abordé certains points dans une communication (inédite), intitulée Rome et les otages barbares, lors d'une rencontre d'historiens britanniques et français, à Edimbourg, en juillet 1954. Sur la pratique des otages dans l'Antiquité et quelques-unes des questions générales ou particulières qu'elle soulève, cf. certaines de mes publications antérieures: résumé d'une communication (23 avril 1952) sur ‘La République romaine et les otages’, dans Bull. Soc. Antiquaires de France 1952–1953, 53–4; ‘Les otages carthaginois à la fin de la deuxième guerre punique,’ dans Annales publiées par Fac. Lettres Toulouse, Pallas, Études sur l'Antiquité 1 (1953). 43–63; ‘Philippe de Macédoine otage à Thèbes,’ dans Rev. Ét. Anc. LVI, 1954, 15–36.
References
1 Carthage: Pol. xv, 18, 8; Livy XXX, 37, 8; App., Lib. 54; Cassius Dio, fr. 57, 82; Zon. IX, 14,11. — Philippe V: Pol. XVIII, 39, 5; Livy XXXIII, 13, 14; Plut., Tit. 9. — Antiochos III: Pol. XXI, 43, 22; Livy XXXVIII, 38, 15; Appian, Syr. 39. — Nabis: Livy XXXIV, 35, 11. — Aitoliens: Pol. XXI, 32, 10; Livy XXXVIII, 11, 6–7.
2 César, BG 1, 14, 6; 27, 3; 28, 2, etc.
3 Je ne trouve aucune formulation de cette doctrine mise au compte d'un Romain. Le chef helvète Divico répond orgueilleusement à César (BG 1, 14, 7): ‘Ita Helvetios a maioribus suis institutes esse, uti obsides accipere, non dare consuerint,’ Ce n'est pas sans une ironie calculée que César place le propos dans la bouche de ceux qu'il va vaincre et plier à ses conditions. Sa force est trop assurée pour qu'il ait besoin, ici ou ailleurs, de l'étaler dans des affirmations analogues: les faits parlent assez clairement.
4 Clélia: surtout Plut., Popl. 19, 8–9, et Livy 11, 13, 4–11. — Fourches caudines: Livy IX, 5, 5; Appien, Samn. IV, 4 et 6; Aulu-Gelle II, 19, 8; XVIL, 2; Zon. VII, 26. — La fin de la phrase prètée par César à Divico (cf. la n. précédente), ‘eius rei populum Romanum esse testem,’ postule l'intention, chez César, d'affirmer que l'armée de L. Cassius Longinus a dû en 107, comme celle de Spurius Postumius en 321, à la fois passer sous le joug (BG 1, 7, 4; 12, 5) et livrer des otages.
5 ‘A vrai dire il essaya d'exiger de certains d'entre eux un genre nouveau d'otages, à savoir des femmes, parce qu'il s'apercevait qu'ils prêtaient peu d'attention aux otages masculins. Néanmoins, il leur permit toujours, et à tous, de reprendre leurs otages toutes les fois qu'ils pouvaient le vouloir.’
6 Athen. XIII, p. 605 e: …πρῶτος ἀνθρώπων εἰς ὁμηρείαν λαβὼν παρἁ Μεταποντίνων γυναῖκας καἱ παρθένους τὰς ἐνδοξοτάτας καὶ καλλίστας διακοσίασ…
7 cf. aussi Diod. XX, 104:… διακοσίας δὲ παρθένους τὰς ἐπιφανεστάτας ἔλαβεν εἰς ὁμηρείαν, οὐχ οὔτω τῆς περὶ τὴν πίστιν ἀσφαλείας χάριν ὡς τῆς ἰδίας ἕνεκεν λαγνείας.
8 Plut., Kleom. 22; 38.
9 VII, 165.
10 Pol. VIII, 36, 3.
11 Tac., Germ. 8: … ‘captivitate, quam longe impatientius feminarum suarum nomine timent, adeo ut efficacius obligentur animi civitatum, quibus inter obsides puellae quoque nobiles imperantur.’ A monsens, Tacite entend signaler par là que les Germains pratiquent entre eux cet usage, et non pas que les Romains ont constaté l'efficacité plus grande d'un precédé imaginé par Auguste. C'est dans le même esprit qu'il mentionne (Germ. 20) que ‘certains’ exigent de préférence, comme otages, les ‘fils des soeurs’; il ne s'agit pas, là non plus, d'une riposte des Romains à la mauvaise foi des Germains.
12 Tac, Ann. XV, 30. Pour le diadème, cf. aussi ibid. 24 et 29; Gagé, J., ‘L'empereur romain et les rois. Politique et protocole’, dans Rev. hist. CCXXI, 1960, pp. 221–260.Google Scholar
13 C'est ce que font de nombreux traducteurs: par exemple, H. Ailloud (CUF 1, 79). En revanche, la traduction de R. Graves, publiée en 1957 dans la collection des Penguin classics 61, précise sans craindre d'ajouter au texte ce qui le rend compréhensible: … send acceptable substitutes ….
14 Traité avec Antiochos III: Pol. XXI, 43, 22; Livy XXXVIII, 38, 15; Appian, Syr. 39. — Sans entreprendre de le démontrer ici, je crois qu'une procédure analogue est envisagée dans le traité imposé aux Aitoliens: Pol. XXI, 32, 10; Livy XXXVIII, 11, 6–7. — On la retrouve encore dans les engagements que Rome fait prendre aux Oxybiens envers Massalia: Pol. XXXIII, 10, 12.
15 Livy XXXII, 2, 3–4; XL, 34, 14. Sur ces otages carthaginois et leur renouvellement, cf. les pp. 52–4 de mon mémoire signalé supra, p. 136, n.*. Suétone a commis, en parlant seulement de la restitution des otages, la même négligence que Tite-Live.
16 Cal. 45: ‘Rursus obsides quosdam abductos e litterario ludo clamque praemissos, deserto repente convivio, cum equitatu insecutus veluti profugos ac reprehensos in catenis reduxit: in hoc quoque mimo praeter modum intemperans.’
17 cf. Walbank, F. W., Philip V of Macedon (Cambridge, 1940) 238–241, 246–7, 250–2.Google Scholar — On ne peut pas parler d'une utilisation directe, afin d'affaiblir la monarchie séleucide, des anciens otages qu'avaient été Antiochos IV Epiphanès et Dèmètrios Ier Sôter; mais la vie à Rome les avait, eux aussi, marqués.
18 Entre autres, Suétone, Aug. 21; Justin XLII, 5; Tac., Ann. II, 1; Res gestae divi Aug. 32, 2 et 33; Cassius Dio LVIII, 26, 2.
19 La distinction n'est pas indifférente, au moins en théorie. Lorsque Suétone (Aug. 48) signale que les fils de plusieurs rois partagèrent l'éducation des jeunes membres de la famille impériale, il s'en faut qu'il s'agisse seulement des otages. Il s'en faut aussi que tous, captifs, réfugiés ou otages, aient vécu à la cour: le fils d'Arminius fut élevé à Ravenne (Tac., Ann. I, 58), si son neveu semble (ibid. XI, 16) l'avoir été à Rome.
20 cf. le raisonnement prêté (Tac., Ann. XI, 16) aux Chérusques adversaires du roi que Claude envoie à ce peuple. Ce roi est le fils du frère d'Arminius, qui (ibid. 11, 9) n'a jamais trahi Rome. Mais le fils même d'Arminius serait inacceptable, parce qu'élevé (ibid. 1, 10) en terre romaine: ‘Frustra Arminium praescribi: cuius si filius, hostili in solo adultus, in regnum venisset, posse extimesci, infectum alimonio, servitio, cultu, omnibus externis.’
21 Les Res gestae, déjà, insistent sur ce thème: 3, 1–2; 26, 3; 27, 2. Il faut en rapprocher l'avis, donné au Sénat (Cassius Dio LIV, 9, 1) et, vers la fin de sa vie, dans l'état de l'empire dressé par Auguste (Tac., Ann. 1, 11), de ne pas procéder à de nouvelles annexions.
- 2
- Cited by