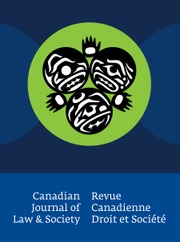L’ouvrage d’Alexandra Bahary-Dionne, préfacé par Emmanuelle Bernheim, explore les pratiques informationnelles des personnes ayant des questionnements juridiques. Comment des individus s’informent-ils de leur(s) droit(s) sur le Web social? Ce Web social facilite-t-il ou non les démarches juridiques des usagers? Les services juridiques en ligne sont-ils pertinents, utiles et de nature à réduire les inégalités d’accès à la justice? À partir d’une analyse des échanges sur deux groupes Facebook d’entraide (un groupe de locataires et un groupe de parents), l’ouvrage apporte des réponses convaincantes à ces questions et à bien d’autres. D’une manière générale, il faut souligner et louer les compétences ethnographiques de l’auteure (la restitution des pratiques des communautés sur le Web est très réussie), sa maîtrise théorique et son excellente connaissance de la littérature sociojuridique. L’effort pour articuler l’approche sociojuridique et sociologie du numérique (plus précisément, sociologie des usages numériques) est bienvenu.
L’ouvrage se compose de cinq chapitres habilement construits et rédigés dans une langue limpide. Après avoir présenté son cadre théorique pour saisir l’usage des médias sociaux en contexte juridique (chapitre 1), l’auteure cartographie la diversité des pratiques informationnelles au sein des groupes étudiés : quels sont les besoins juridiques exprimés? quelles informations y sont échangées (chapitre 2)? Ensuite, l’enquête s’efforce de mettre en lumière les formes de conscience du droit au sein des groupes. L’expérience et les représentations que les internautes se font du droit conduisent à des stratégies informationnelles et à des attentes de justice contrastées (chapitre 3). Les expériences individuelles des internautes sont-elles susceptibles de produire un savoir collectif, voire une expertise collective, permettant de s’orienter, d’une manière plus assurée, dans les marais des problèmes juridiques (chapitre 4)? Réintroduisant une dimension plus politique, l’enquête se concentre enfin sur la question des rapports entre les inégalités d’accès à la justice et les disparités informationnelles dans les groupes étudiés (chapitre 5). Au terme de cette trajectoire, l’étude d’Alexandra Bahary-Dionne apparaît comme une contribution particulièrement réussie à la compréhension des savoirs qui fondent et qui pourraient fonder l’action publique en justice. Pour y parvenir, elle invite à se défaire de certains dualismes encombrants (droit formel/droit vivant, droit des livres/droit en action, etc.) et à prendre au sérieux les savoirs profanes (faire travailler ce savoir profane dans le droit et non contre lui) comme des vecteurs de l’agir juridique.
L’ouvrage s’inscrit dans l’intérêt accru porté aux non-professionnels du droit, aux profanes (même si l’auteure conteste in fine la distinction entre professionnels et profanes). Il s’agit de comprendre ce que signifie pour un citoyen ordinaire « avoir droit » (avoir droit ou avoir un droit ne signifie pas qu’on y accède ou le réclame systématiquement). Ici, la réflexion connecte cette question des usages ordinaires à la connaissance et à l’information juridiques. L’objectif est bien de saisir comment le Web social peut contribuer à équiper juridiquement les profanes dans leur demande de justice (au double sens d’étancher leur soif de justice et de la saisir effectivement). L’outil Web rapproche-t-il ces citoyens ordinaires de la justice ou est-ce une illusion? Que peut-il faire ou ne pas faire pour eux? Comment ces citoyens s’approprient-ils cet outil et le font-ils travailler au service de leurs intérêts? Le travail d’Alexandra Bahary-Dionne apporte une foule de remarques judicieuses et pénétrantes en évitant aussi bien le technosolutionnisme béat (qui imagine qu’internet serait la solution à tous les maux de la justice) et le scepticisme technologique (qui rejette la technique comme un danger vital pour le droit).
Le geste méthodologique de l’auteure est celui défendu par le courant de la conscience du droit (Legal Consciousness Studies) qui connaît depuis plusieurs années un incontestable succès dans les études sociojuridiques. Il opère un triple déplacement en s’intéressant à des individus ordinaires (et non des juristes de métier), aux usages (et non aux règles de droit) et aux formes de dissémination juridique (le droit est partout et pas seulement dans les documents juridiques). À cet égard, l’ouvrage s’appuie efficacement sur l’enquête maîtresse de Patricia Ewick et Susan Silbey, The Common Place of Law: Stories from Everyday Life Footnote 1. Leur célèbre trilogie (devant le droit, avec le droit et contre le droit) donne à Alexandra Bahary-Dionne la structure de son chapitre 3, consacré à « la conscience du droit en contexte numérique ». Dans ce chapitre, à partir d’une analyse des conversations, l’auteure expose les représentations spécifiques que les groupes étudiés se font du droit. Elle montre tout l’éventail des conceptions juridiques portées par les communautés numériques qui ont saisi combien le droit constitue une ressource dans leurs efforts pour se faire entendre. Ressource certes utile, susceptible d’instrumentalisation, mais fréquemment récalcitrante et frustrante. Le schéma triple d’Ewick et Silbey démontre, cette fois encore, sa capacité clarificatrice et didactique. Il pèche parfois par son schématisme et sa rigidité : Alexandra Bahary-Dionne ne sait pas toujours dans lequel des trois modèles placer certaines représentations du droit et est parfois obligée à des contorsions lorsque le « devant le droit » est aussi du « avec le droit » (p. 107) ou lorsque le « contre le droit » relève d’un usage « avec le droit » (p. 119).
Le chapitre le plus personnel et le plus inspirant est celui consacré à la conscience collective du droit et à une « jurisprudence de l’expérience » (chapitre 5). L’emploi du terme « conscience collective » est sans doute mal choisi ici : le chapitre s’écarte aussi bien du cadre des Legal Consciousness Studies que de la tradition durkheimienne. En réalité, l’auteure mobilise non pas le registre de la conscience, mais celui de l’expérimentation. L’objectif est de montrer comment des individus, s’appuyant sur des expériences personnelles plurielles, construisent collectivement des réponses juridiques à partir du Web social. Loin d’être une plongée dans les méandres de la psychologie des internautes, l’ouvrage suit à la trace les pratiques d’accumulation des données, et la façon dont les acteurs corrigent certaines idées et se coordonnent entre eux pour pouvoir agir. Ces communautés de pratiques produisent un savoir original, véritable stock d’informations activables en situation et pour des situations à venir (d’où cette judicieuse idée d’une « jurisprudence de l’expérience »).
Page après page, Alexandra Bahary-Dionne pose ainsi les bases d’un véritable programme de recherche sur le rôle des savoirs citoyens dans l’univers juridique. Il faut souhaiter qu’elle soit suivie par d’autres. Sur ce chemin des savoirs juridiques profanes, son livre constitue d’ores et déjà une étape marquante.