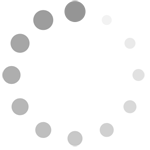Refine search
Actions for selected content:
11 results
“Called Upon to Collaborate Effectively in the Economic Progress of the Colony”: Measuring Algerian Women’s Work in the Interwar Period
-
- Journal:
- International Labor and Working-Class History / Volume 108 / October 2025
- Published online by Cambridge University Press:
- 08 October 2025, pp. 217-234
-
- Article
-
- You have access
- Open access
- HTML
- Export citation
1 - Handicrafts
-
- Book:
- Fair Trade
- Published online:
- 01 May 2025
- Print publication:
- 15 May 2025, pp 19-42
-
- Chapter
- Export citation
8 - Economic Implications of Diversity in West Germany
- from Part IV - Long-Run Economic Consequences of Uprooting
-
- Book:
- Uprooted
- Published online:
- 07 November 2024
- Print publication:
- 21 November 2024, pp 200-227
-
- Chapter
- Export citation
4 - Pogroms and Revolution
- from Part II - Liberty, Unity, Equality: 1840–1870
-
- Book:
- Germany through Jewish Eyes
- Published online:
- 14 November 2024
- Print publication:
- 21 November 2024, pp 63-77
-
- Chapter
- Export citation
Edcraft: Gamified Handicrafts as an Inspiration for Teenagers to Practice Upcycling
-
- Journal:
- Australian Journal of Environmental Education / Volume 40 / Issue 4 / August 2024
- Published online by Cambridge University Press:
- 01 October 2024, pp. 758-769
-
- Article
-
- You have access
- Open access
- HTML
- Export citation
13 - The Rural Economy
- from Part II - 1000 to 1800
-
-
- Book:
- The Cambridge Economic History of China
- Published online:
- 07 February 2022
- Print publication:
- 24 February 2022, pp 484-521
-
- Chapter
- Export citation
BLUEPRINT TEXTILES IN SOUTHERN AFRICA - isiShweshwe: A History of the Indigenisation of Blueprint in Southern Africa. By Juliette Leeb-du Toit. Pietermaritzburg, South Africa: University of KwaZulu-Natal Press, 2017. Pp. 312. R 955, paperback (ISBN: 978-1-86914-314-5).
-
- Journal:
- The Journal of African History / Volume 61 / Issue 1 / March 2020
- Published online by Cambridge University Press:
- 31 March 2020, pp. 129-130
-
- Article
- Export citation
SHORTER NOTICES - Grasland: Eine afrikanische Kultur. By Hans Knöpfli. Wuppertal: Peter Hammer, 2008. Pp. 328, 694 colour illustrations. €59, hardback (isbn978-3-77950-197-8).
-
- Journal:
- The Journal of African History / Volume 50 / Issue 2 / July 2009
- Published online by Cambridge University Press:
- 07 September 2009, pp. 327-328
-
- Article
- Export citation
SOCIAL AGENCY AND IRON WORKING IN EQUATORIAL AFRICA Pride of Men: Ironworking in 19th Century West Central Africa. By COLEEN E. KRIGER. Portsmouth NH: Heinemann; Oxford: James Currey; and Cape Town: David Philip, 1999. Pp. xix+261. £40 (ISBN 0-85255-682-9); £15.95, paperback (ISBN 0-85255-632-2).
-
- Journal:
- The Journal of African History / Volume 44 / Issue 3 / November 2003
- Published online by Cambridge University Press:
- 14 November 2003, pp. 518-520
-
- Article
- Export citation
GENDER, COLONIALISM AND ECONOMIC DYNAMICS IN NIGERIA The Bluest Hands: A Social and Economic History of Women Dyers in Abeokuta (Nigeria), 1890–1940. By JUDITH A. BYFIELD. Portsmouth NH: Heinemann; Oxford: James Currey, 2002. Pp. xxxix+263. $64.95; £45 (ISBN 0-325-07009-1); $24.95; £16.95, paperback (ISBN 0-325-07008-3).
-
- Journal:
- The Journal of African History / Volume 44 / Issue 3 / November 2003
- Published online by Cambridge University Press:
- 14 November 2003, pp. 524-526
-
- Article
- Export citation